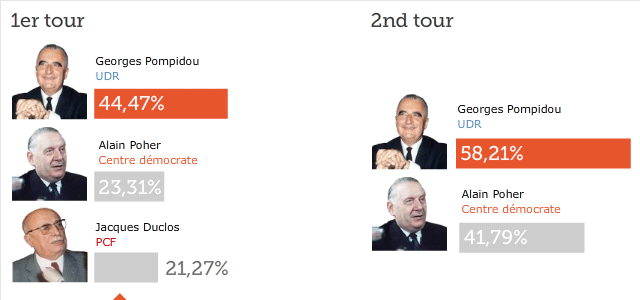21/02/2018
Maurice Audin, témoignage. « Une saloperie de communiste, il faut le faire disparaître »
Parcours "Maurice Audin" d'Ernest Pignon Ernest, d'Alger 2003
Maud Vergnol, l'Humanité
Le témoignage d’un ancien appelé, qui pense avoir « enterré » le corps de Maurice Audin, torturé par l’armée française en juin 1957, relance l’exigence de vérité et ravive les horreurs d’une guerre dont l’État français n’a toujours pas assumé sa responsabilité.
« Je crois que c’est moi qui ai enterré le corps de Maurice Audin. » Jacques Jubier (1) a la voix un peu tremblante. Il hésite, regarde autour de lui. Mais il veut témoigner. Comme près de deux millions d’appelés, il avait préféré oublier, se taire « pour protéger (sa) famille ». Et puis, le temps a fait son œuvre. Et la peur de « représailles » de la Grande Muette s’est dissipée. C’est l’entretien publié dans nos colonnes, le 28 janvier, avec le mathématicien Cédric Villani qui l’a convaincu. Si un député de la majorité est déterminé à faire reconnaître la responsabilité de l’État français dans l’assassinat, en juin 1957, du jeune mathématicien communiste Maurice Audin, c’est que les langues peuvent commencer à se délier… Et l’exigence d’une reconnaissance de ce crime d’État, bientôt aboutir.
Avec « l’affaire » Maurice Audin, c’est la pratique généralisée de la torture pendant la guerre d’Algérie qui refait surface. Une sauvagerie institutionnalisée, dont le refoulement a rongé comme une gangrène la société française. Mais les mécanismes de fabrication de l’oubli finissent toujours par céder. Ce nouveau témoignage en est la preuve.
Alors que la capitale est engourdie par la neige, Jacques Jubier, 82 ans, a fait le voyage depuis Lyon pour soulager sa conscience et « se rendre utile pour la famille Audin », assure-t-il. Son histoire est d’abord celle du destin de toute une génération de jeunes appelés dont la vie a basculé du jour au lendemain. En 1955, après le vote « des pouvoirs spéciaux », le contingent est envoyé massivement en Algérie. Jacques n’a que 21 ans. Fils d’un ouvrier communiste, résistant sous l’occupation nazie en Isère, il est tourneur-aléseur dans un atelier d’entretien avant d’être incorporé, le 15 décembre 1955.
Un mois plus tard, le jeune caporal prendra le bateau pour l’Algérie, afin d’assurer des « opérations de pacification », lui assure l’armée française. Sur l’autre rive de la Méditerranée, il découvre la guerre. Les patrouilles, les embuscades, les accrochages avec les « fels », la solitude, et surtout, la peur, permanente. Cette « guerre sans nom », il y participe en intégrant une section dans un camp perché sur les collines, sur les hauteurs de Fondouk, devenue aujourd’hui Khemis El Khechna, une petite ville située à 30 kilomètres à l’est d’Alger. Jacques Jubier nous tend son livret militaire, puis les photographies que l’armée française n’a pas censurées : d’abord, des paysages sublimes de montagnes et vallées, où on aperçoit le barrage du Hamiz, qui draine l’extrémité orientale de la grande plaine algéroise.
« Il y avait des volontaires pour la torture, qui ne se faisaient pas prier »
Quelques clichés de ce camp isolé ont échappé à la censure. Sur l’un d’entre eux, un Algérien tient à peine sur ses jambes aux côtés de cinq jeunes soldats, une pelle à la main, qui sourient. Jacques est l’un d’eux. En arrière-plan, on distingue une cabane en troncs et ciment. « C’est ici qu’ils torturaient les Algériens, explique-t-il. Moi, au début, je les appelais “les partisans”, et puis j’ai vite compris qu’il fallait que j’arrête. » Pendant des mois, la bière est le seul « divertissement » de jeunes soldats qui s’interrogent encore sur ces étranges opérations de « pacification ». « On a vite compris de quoi il s’agissait. Il y avait des volontaires pour la torture. Certains ne se faisaient pas prier. Moi, j’ai refusé. Mon capitaine n’a pas insisté », assure-t-il. Mais il a vu, aux premières loges, le conditionnement, puis l’engrenage de la violence, individuelle et collective.
« Un trou était creusé dans le sol du camp, où les prisonniers étaient détenus entre deux séances de torture, raconte-t-il. Ils ne repartaient jamais vivants. C’était le principe. Les soldats ne se rendaient pas compte de l’horreur de ces exactions. On était conditionnés, mais nous ne réagissions pas tous de la même manière. J’ai vu des choses horribles que je n’ai jamais oubliées : la gégène, mais bien pire encore. » Dans cette guerre de renseignements, les appelés ont très vite été encouragés à commettre des exécutions sommaires et des actes de torture, avec le sentiment d’obéir à des ordres et donc de servir leur pays. Dès le début, non seulement les gouvernements savaient, mais couvraient et légiféraient.
« Une scène m’a longtemps hanté, confie-t-il avec émotion. Un petit Kabyle de 14-15 ans n’avait pas été jeté dans la fosse avec les autres Algériens. Les soldats français pensaient que ce gamin allait les aider à faire parler les autres. Mais il était devenu trop encombrant. Un jour, on part en patrouille et le capitaine l’emmène avec nous. Il s’arrête au milieu de la route et lui dit qu’il peut partir. Le petit refuse d’abord, comme s’il sentait quelque chose… et puis, il s’est enfui en courant. Ils lui ont tiré dessus avec un fusil-mitrailleur. Il a pris des rafales, est tombé à terre. Il n’était pas mort. Je revois cette scène comme si c’était hier. Le capitaine a dit aux gars : achevez-le ! Et là, j’ai vu des sauvages, ils s’y sont mis à plusieurs. Et encore, c’étaient des gars du contingent, donc vous imaginez les paras… Ils lui ont éclaté la cervelle. C’était une scène d’horreur. Je me souviens de ses grands yeux clairs qui regardaient vers le ciel… Des sauvages… »
« Là-bas, les gars devenaient comme des animaux »
Déserter ? « C’était impossible ! Chaque soir, j’appréhendais ce qu’on allait me demander de faire le lendemain. Comme les Algériens ne sortaient jamais vivants du camp, il fallait, pour l’armée, se débarrasser des corps. On m’a donc demandé de les charger dans un GMC (véhicule de l’armée), bâché, et on devait les abandonner devant les fermes. Je ne sais pas ce que les habitants en faisaient, une fois qu’ils les trouvaient, ils devaient les enterrer sur place. Moi, je voulais du respect pour les morts. Certains osaient même fouiller les corps pour trouver trois pièces. Là-bas, les gars devenaient comme des animaux. »
Si Jacques ne songe pas à la désertion, il fait valoir une blessure au genou et finit par être muté à la compagnie de commandement pour l’entretien des véhicules dans la ville de Fondouk. C’est ici que, un après-midi du mois d’août, un adjudant de la compagnie lui demande de bâcher un camion : « Un lieutenant va venir et tu te mettras à son service. Et tu feras TOUT ce qu’il te dira. » Le lendemain matin, le temps est brumeux et le ciel bas quand un homme « au physique athlétique » s’avance vers lui, habillé d’un pantalon de civil mais arborant un blouson militaire et un béret vissé sur la tête. C’était un parachutiste. « On va accomplir une mission secret-défense, me dit le gars. Il me demande si je suis habile pour faire des marches arrière. Puis, si j’ai déjà vu des morts. Puis, si j’en ai touché, etc. » « Malheureusement oui », relate l’ancien appelé. « C’est bien », lui répond le para, qui le guide pour sortir de Fondouk et lui demande de s’arrêter devant une ferme. « Est-ce que tu as des gants ? Tu en auras besoin… »
Jacques s’arrête à sa demande devant l’immense portail d’une ferme assez cossue qui semble abandonnée. Il plisse les yeux pour en décrire le moindre détail qui permettrait aujourd’hui de l’identifier. « Descends et viens m’aider ! » lui lance le para, dont il apprendra l’identité bien plus tard : il s’agirait de Gérard Garcet (lire l’Humanité du 14 janvier 2014), choisi par le sinistre général Aussaresses pour recruter les parachutistes chargés des basses besognes. Le même qui fut, plus tard, désigné par ses supérieurs comme l’assassin de Maurice Audin…
« On les a passés à la lampe à souder pour qu’ils ne soient pas identifiés »
Le tortionnaire ouvre une cabane fermée à clé, dans laquelle deux cadavres enroulés dans des draps sont cachés sous la paille. « J’ai d’abord l’impression de loin que ce sont des Africains. Ils sont tout noirs, comme du charbon », se souvient Jacques, à qui Gérard Garcet raconte, fièrement, les détails sordides : « On les a passés à la lampe à souder. On a insisté sur les pieds et les mains pour éviter qu’on puisse les identifier. Ces gars qu’on tient au chaud depuis un bout de temps, il faut maintenant qu’on s’en débarrasse. C’est une grosse prise. Il ne faut jamais que leurs corps soient retrouvés. » « C’est des gens importants ? » lui demande le jeune appelé. « Oui, c’est le frère de Ben Bella et l’autre, une saloperie de communiste. Il faut les faire disparaître. »
Un sinistre dialogue que Jacques relate des sanglots dans la voix. C’est qu’il est aujourd’hui certain qu’il s’agissait bien de Maurice Audin. Quant à l’autre corps, il est impossible qu’il s’agisse d’un membre de la famille d’Ahmed Ben Bella, l’un des chefs historiques et initiateurs du Front de libération nationale (FLN). Sans doute un dirigeant du FLN, proche de Ben Bella… À moins que Garcet n’ait affabulé ? « Je ne crois vraiment pas. Vous savez, ces hommes-là, ils se croyaient dans leur bon droit. »
« Après les avoir enterrés, on a repris la route au nord du barrage du Hamid, poursuit-il. Je ne disais pas un mot. Après vingt minutes de trajet environ, on s’est arrêtés devant un portail. Il n’était pas cadenassé, celui-là. Ça m’a étonné. Au milieu de la ferme, il y avait une sorte de cabane sans toit avec des paravents, comme un enclos entouré de bâches. Il m’a demandé d’attendre. Quand il a ouvert la bâche : quatre civils algériens avaient les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Ils leur avaient fait creuser un énorme trou, qui faisait au moins 4 mètres de profondeur. Dans le fond, j’ai aperçu des seaux, des pioches et une échelle. Il m’a demandé de recouvrir les deux cadavres. Ce que j’ai fait. D’abord il m’a félicité. Puis, me dit de n’en parler à personne, que j’aurais de gros ennuis si je parle. Et ma famille aussi. Il me menace. On est rentrés à Fondouk et il me demande de le déposer devant les halles du marché. »
Inciter les derniers témoins à parler
Et puis, Jacques a oublié, pour continuer à vivre. Comme toute une génération marquée à vie, murée dans le silence et la honte, il n’a pas parlé. Ni de cette nuit-là, ni du reste. Dans la Question, Henri Alleg relate un dialogue avec ses bourreaux à qui il dit, épuisé par la torture : « On saura comment je suis mort. » Le tortionnaire lui réplique : « Non, personne n’en saura rien. » « Si, répondit Henri Alleg, tout se sait toujours… »
La recherche de la vérité, entamée à Alger par Josette Audin et relayée en France, n’est toujours pas terminée, plus de soixante ans après les faits. Le récit de Jacques permettra-t-il de recoller certains morceaux du puzzle ? Et d’inciter les derniers témoins à parler ? Si son témoignage, qui a été transmis à la famille Audin, ne fait pas de doute sur sa sincérité et que le faisceau de coïncidences est troublant, il n’existe qu’une chance infime pour qu’il s’agisse bien de Maurice Audin. « Comme dans toutes les disparitions, l’absence du corps de la victime empêche d’y mettre un point final et rend impossible la cicatrisation des plaies de ceux que la disparition a fait souffrir », explique Sylvie Thénault.
Pour l’historienne (2), qui a travaillé avec la famille Audin, ce témoignage, comme les révélations qui ont émergé dans les années 2011-2014, ont des fragilités inhérentes à leur caractère tardif. « Mais il est possible d’imaginer qu’un jour un document émerge, contenant un élément nouveau qui, telle une pièce manquante à un puzzle, viendrait conforter l’une ou l’autre des hypothèses envisageables, voire en prouver une au détriment des autres. » Peut-être que, comme l’affirmait Benjamin Stora dans la Gangrène et l’oubli, l’écriture de l’histoire de la guerre d’Algérie ne fait que re-commencer.
 Maurice Audin, né le à Béja (Tunisie) et mort à Alger en 1957, est un mathématicien français, assistant à l’université d’Alger, membre du Parti communiste algérien et militant de l'indépendance algérienne.
Maurice Audin, né le à Béja (Tunisie) et mort à Alger en 1957, est un mathématicien français, assistant à l’université d’Alger, membre du Parti communiste algérien et militant de l'indépendance algérienne.
Après son arrestation le 11 juin 1957 au cours de la bataille d'Alger, il meurt à une date inconnue.
Pour ses proches ainsi que pour nombre de journalistes et d'historiens, notamment Pierre Vidal-Naquet, il est mort pendant son interrogatoire par des parachutistes. Cette thèse a longtemps été rejetée par l'armée et l'État français, qui affirmait qu'il s'était évadé, jusqu'à ce que le général Aussaresses affirme avoir donné l'ordre de le tuer. En juin 2014, le président Hollande a pour la première fois reconnu officiellement que Maurice Audin était mort en détention, sans toutefois rendre publics les documents le confirmant.
Sources Wikipédia
11:24 Publié dans Biographie, Guerre, L'Humanité, PCF, Peinture, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : audin maurice, biographie, témoignage, assassinat |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2017
Élection présidentielle de 1969, Jacques Duclos soutenu par le PCF obtient 21,27 % des suffrages
Le premier Juin 1969, premier tour des élections présidentielles, le candidat présenté par le PCF obtient 21,27 % des suffrages exprimés, jamais depuis un candidat présenté ou soutenu par le PCF n'a obtenu un tel score. Pourtant il est éliminé pour participer au second tout précédé par Georges Pompidou qui obtint 44,47 % et fut élu 15 jours plus tard président de la République, et Alain Poher 23,31 %. Le candidat présenté par le Parti Socialiste (SFIO) s'écroule en obtenant 5,01 % des voix, suivi par Michel Rocard qui obtint 3,61 %, et Alain Krivine pour la Ligue communiste 1,06 %.
Cela n'empêcha pas 12 ans après en 1981 la victoire du Parti socialiste réunifié avec l'élection de François Mitterand à la présidence de la République.
L'élection présidentielle qui s'est tenue lors de la Cinquième République française et la deuxième au suffrage universel direct.
Le premier tour s'est déroulé le 1er juin et le second le 15 du même mois. Elle vit la victoire de Georges Pompidou dans des circonstances assez particulières, aucun candidat de gauche n'accédant au second tour
Le 28 avril 1969, un communiqué laconique tombe de Colombey : « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Charles de Gaulle, premier président de la République de la Ve République, désavoué la veille par 52,41 % des électeurs français à l’occasion du référendum portant sur le transfert de certains pouvoirs aux régions et la transformation du Sénat, quitte ses fonctions comme il l'avait promis en cas de victoire du « non ». Avec le départ du général, une page se tourne : la Cinquième République, désormais, n'est plus dirigée par son inspirateur et c'est à l'électorat de choisir son successeur.
Conformément à la Constitution française, c’est Alain Poher, alors président du Sénat, qui succède à Charles de Gaulle en tant que président de la République par intérim. Une élection présidentielle anticipée doit avoir lieu le 1er juin 1969. À la suite du raz de marée gaulliste de l'élection anticipée qui avait suivi Mai 68, le courant politique majoritaire de la France est la droite : l’Union pour la défense de la République (UDR), formation gaulliste, soutenue par les Républicains indépendants, libéraux menés par le populaire Valéry Giscard d'Estaing, détient la majorité absolue au Parlement (60 % des sièges de l’Assemblée nationale après sa dissolution par de Gaulle en réponse à la crise de mai 68 durant laquelle les partis de gauche, tenus pour partiellement responsables des événements, avaient essuyé leur plus sévère défaite depuis le scrutin de 1958).
La majorité en place ne tarde guère à trouver son candidat : Georges Pompidou, ancien premier ministre de de Gaulle a su, depuis son éviction au profit de Couve de Murville, se faire soutenir par l’ensemble de la majorité parlementaire (avec, notamment, le soutien indéfectible de Giscard d’Estaing).
En l’absence de la droite nationaliste1, Pompidou est alors concurrencé dans les sondages par Poher, qui, soutenu par la formation de centre droit Progrès et démocratie moderne, ne semble pas décidé à lui abandonner l’Élysée. La gauche, qui avait pourtant réussi à se rassembler derrière la candidature de François Mitterrand en 1965, est quant à elle victime des divisions en son sein, les socialistes de la SFIO refusant de collaborer avec le Parti communiste français.
Alain Poher ne parvient pas à imposer une crédibilité que l'ancien premier ministre Pompidou possède. Ce dernier sait se montrer habilement à la fois différent et fidèle au Général de Gaulle. Il s'affiche entre Giscard d'Estaing, libéral, moderne et les gaullistes historiques, promettant une certaine libéralisation économique, dans le maintien de l'ordre national. La campagne de Gaston Deferre, qui s'affiche dans un duo avec Pierre Mendès France qui serait son premier ministre, tourne vite à l'échec : technique, rappelant la Quatrième République, Pierre Mendès France pourtant populaire un an auparavant, contraste avec Gaston Deferre dont la candidature manque de crédibilité et de charisme. Cet échec contraste avec la faconde et l'accent du candidat communiste, Jacques Duclos, et avec l'agitation brillante de l'innovant PSU, Michel Rocard. Les autres candidats sont le trotskiste Alain Krivine, étudiant d'extrême gauche sous les drapeaux et l'entrepreneur indépendant Louis Ducatel.
La campagne de Gaston Deferre se termine en désastre électoral pour la SFIO, largement distancée par le PCF et presque rattrapée par le PSU. Seul Poher peut désormais vaincre Pompidou. Si Deferre vote pour lui, au soir du premier tour, Duclos indique à ses électeurs que les deux candidats en lice, dont aucun n'est de gauche, sont « bonnet blanc et blanc bonnet » et doivent donc être renvoyés dos à dos par un vote blanc ou une abstention. Dès lors, Poher ne peut plus gagner.
JACQUES DUCLOS (1895-1975)
 Fils d'Antoine Duclos (artisan-charpentier) et d'une mère couturière, Jacques Duclos est apprenti-pâtissier dès l'âge de douze ans. Il reste avide de lecture pendant toute son adolescence.
Fils d'Antoine Duclos (artisan-charpentier) et d'une mère couturière, Jacques Duclos est apprenti-pâtissier dès l'âge de douze ans. Il reste avide de lecture pendant toute son adolescence.
En 1915, pendant la grande guerre, il sert dans l'armée française et participe à la bataille de Verdun. Blessé, vite soigné, il est redirigé vers le Chemin des Dames où il est fait prisonnier. Son frère aîné Jean laisse sur les champs de bataille son nez et un œil.
Il adhère au Parti communiste dès sa fondation en 1920. Un an plus tard, il devient le secrétaire de la section du 10e arrondissement de Paris tout en prenant des responsabilités à l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC). Il exerce son métier de chef-pâtissier jusqu'en 1924
Membre du comité exécutif de l'Internationale communiste. Député de Paris dès 1926, il est vice-président de la Chambre du Front populaire (1936). Sous l'Occupation, il est l'un des organisateurs de l'action clandestine du Parti communiste, et sa tête est mise à prix par les Allemands. De 1946 à 1958, il est réélu à toutes les consultations et préside à l'Assemblée le groupe parlementaire communiste. Le 28 mai 1952, victime d'une manœuvre policière (on l'accuse d'avoir transporté des pigeons voyageurs), il est arrêté au moment des manifestations organisées par la C.G.T. et le P.C.F. contre la venue à Paris du général Ridgway, emprisonné, puis libéré à la suite d'un important mouvement populaire de protestation. Il perd son siège de député en novembre 1958, mais il entre au Sénat en avril 1959 où il préside, jusqu'à sa mort, le groupe communiste.
Candidat du Parti communiste à la présidence de la République en 1969, il recueille 4,8 millions de voix. Tribun redoutable, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels plusieurs tomes de Mémoires, son histoire se confond avec celle de son parti dont il est devenu un leader historique. S'y étant engagé sans défaillance, il a pu déclarer, en juin 1969 : « J'ai autant de raisons d'être communiste qu'à vingt-quatre ans, et c'est ce qui éclaire ma vie. » En 1968, Duclos ne devait finalement pas s'opposer à la condamnation de l'intervention russe en Tchécoslovaquie. Il reçut en octobre 1971, à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire, l'ordre de Lénine « pour les grands services rendus au mouvement communiste et ouvrier international ».
Sources Wikipédia et Universalis
16:40 Publié dans Actualité, Biographie, PCF | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : présidentielles, pcf, jacques duclos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2016
L'HUMANITE CLANDESTINE
« Du pain et des armes » : Le titre de l’éditorial résume en ce printemps 1942 deux fondements majeurs de la résistance communiste, qu’un article, « L’appel au combat », développe.
Le pain : évoquant l’ampleur des manifestations du 14 Juillet, l’article insiste sur la lutte contre la pénurie alimentaire et le pillage des richesses par les nazis. Il appelle les ouvriers à revendiquer jusqu’à la grève, les ménagères à s’unir et à manifester, les paysans à ne pas donner leurs récoltes « aux boches ». Ces consignes sont en concordance avec la montée du mécontentement (Pétain a parlé en août 1941 du « vent mauvais » qui souffle sur la France) qu’atteste entre autres la manifestation de ménagères rue de Buci le 31 mai 1942 – une autre est en cours d’organisation, rue Daguerre, pour le 1er août.
Les armes : l’article en élargit le sens, qualifiant d’« arme terrible » les sabotages (machines, moteurs, matériel ferroviaires) et la lutte pour empêcher les départs d’ouvriers en Allemagne : en mai, l’occupant exige le transfert dans le Reich d’ouvriers qualifiés, et en juin Vichy accepte le principe de la « Relève », envoi de main d’œuvre contre libération de prisonniers – de fait un marché de dupes. En juin et juillet, l’Humanité dénonce la manœuvre. Dans notre numéro, un autre article, « N’allez pas en Allemagne », exhorte les ouvriers à refuser ce transfert, soulignant que « Mieux vaut lutter en France en hommes libres que travailler en esclaves au pays de la croix gammée ».
Recruter les militants communistes les plus actifs, rôle essentiel de la lutte armée
Une place essentielle est donnée aux francs-tireurs et partisans (le sigle FTP n’apparaît pas encore), structurés en avril 1942 dans la logique de la lutte armée lancée l’été 1941 : prendre des armes à l’ennemi, tuer les « boches » et les traîtres, être ouvert à tous les patriotes, recruter les militants communistes les plus actifs, rôle essentiel de la lutte armée pour que s’ouvre un second front et pour préparer le soulèvement armé de la nation.
Clin d’œil aux gaullistes : l’Humanité du 17 juillet cite parmi les manifestations du 14 Juillet la revue à Londres des « troupes de la France combattante », terme utilisé ce jour-là pour la première fois (au lieu de « France libre ») par de Gaulle attentif aux contacts en cours avec la Résistance intérieure. L’éditorial de notre numéro fait des francs-tireurs « l’avant-garde de la France combattante ». Autre signe : dans l’hommage aux fusillés figure d’Estienne d’Orves (Honoré et non Jean), premier gaulliste exécuté par les Allemands le 29 août 1941. De premiers contacts existent au printemps 1942 entre France libre et PCF, via le colonel Rémy, agissant il est vrai sans mandat. Ils conduiront en janvier 1943 à l’envoi à Londres de Fernand Grenier comme représentant du PCF auprès du général de Gaulle.
Voici des extraits de cet article signé « Le Parti communiste français (SFIC) » : « Jacques Solomon, docteur ès sciences, (…) a été fusillé sans jugement, après avoir été maintenu au secret depuis la date de son arrestation. (…) Georges Politzer, agrégé de philosophie, (…) a été maintenu au secret comme J. Solomon et fusillé aussi sans jugement. (…) Nous saluons avec émotion (leur) mémoire, (…) leurs noms seront inscrits à jamais parmi les noms des héros morts pour la France et le progrès humain, aux côtés des noms de Jean d’Estienne d’Orves, Pierre Semard, Gabriel Péri, Jean Catelas, etc. (…) Nous nous vengerons. »
Arrêtés par la police française le 15 février (Politzer) et le 2 mars 1942 (Solomon), livrés aux Allemands, fusillés le 23 mai, ces deux militants communistes ont lancé la première revue clandestine pour les intellectuels, l’Université libre (novembre 1940), et en février 1941 la Pensée libre, avec Jacques Decour, professeur d’allemand, arrêté le 17 février 1942 et fusillé le 30 mai. Ces revues dénoncent la politique vichyste, fustigent l’idéologie raciste nazie et marquent la naissance de la résistance intellectuelle communiste dans une période où subsistent des contradictions dans la ligne politique (dénonciation de la « guerre impérialiste », libération sociale comme condition de la libération nationale).
La création du Front national de lutte pour l’indépendance par le PCF en mai 1941 et l’agression contre l’URSS en juin clarifient la situation et favorisent l’union des intellectuels refusant l’oppression. En juillet 1941, Aragon lance l’idée d’unir les écrivains autour d’un journal, les Lettres françaises, dont l’élaboration commence avec des non-communistes. Sa sortie, prévue en février 1942 mais stoppée par l’arrestation de son directeur, Jacques Decour, aura lieu en septembre. L’année 1942 est celle de la mise en place du Comité national des écrivains (CNE), dont les Lettres françaises deviennent l’organe en 1943, avec des auteurs de toutes tendances, communistes, comme Paul Eluard ou Elsa Triolet, ou non, comme Jean Paulhan, Jean Guéhenno, François Mauriac, Jean-Paul Sartre, Jean Bruller (Vercors), souvent issus du réseau des éditions Gallimard. Dans le même temps se structurent les résistants d’autres professions intellectuelles, musiciens, artistes, juristes, etc.
Dans l’Humanité du 24 juillet 1942 « Du pain et des armes. Tel est le cri qu’ont fait retentir les manifestants du 14 Juillet. (…) La résistance ouvrière aux départs en Allemagne s’accentue. Le devoir des ouvriers français est de lutter par tous les moyens afin de ne pas aller travailler pour l’ennemi. Les patriotes français ont pour devoir de renforcer les détachements de francs-tireurs et partisans qui sont, sur le sol de la patrie, l’avant-garde en armes de la France combattante. »
10:04 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, PCF | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'humanité clandestine, libération |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |