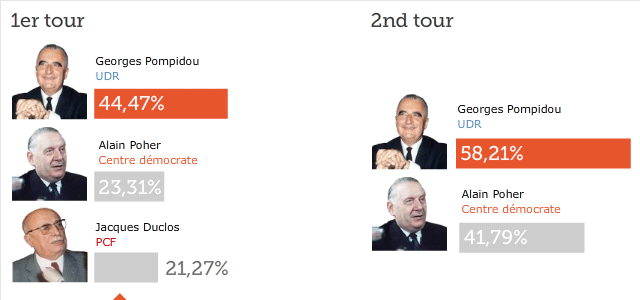25/04/2017
Élection présidentielle de 1969, Jacques Duclos soutenu par le PCF obtient 21,27 % des suffrages
Le premier Juin 1969, premier tour des élections présidentielles, le candidat présenté par le PCF obtient 21,27 % des suffrages exprimés, jamais depuis un candidat présenté ou soutenu par le PCF n'a obtenu un tel score. Pourtant il est éliminé pour participer au second tout précédé par Georges Pompidou qui obtint 44,47 % et fut élu 15 jours plus tard président de la République, et Alain Poher 23,31 %. Le candidat présenté par le Parti Socialiste (SFIO) s'écroule en obtenant 5,01 % des voix, suivi par Michel Rocard qui obtint 3,61 %, et Alain Krivine pour la Ligue communiste 1,06 %.
Cela n'empêcha pas 12 ans après en 1981 la victoire du Parti socialiste réunifié avec l'élection de François Mitterand à la présidence de la République.
L'élection présidentielle qui s'est tenue lors de la Cinquième République française et la deuxième au suffrage universel direct.
Le premier tour s'est déroulé le 1er juin et le second le 15 du même mois. Elle vit la victoire de Georges Pompidou dans des circonstances assez particulières, aucun candidat de gauche n'accédant au second tour
Le 28 avril 1969, un communiqué laconique tombe de Colombey : « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Charles de Gaulle, premier président de la République de la Ve République, désavoué la veille par 52,41 % des électeurs français à l’occasion du référendum portant sur le transfert de certains pouvoirs aux régions et la transformation du Sénat, quitte ses fonctions comme il l'avait promis en cas de victoire du « non ». Avec le départ du général, une page se tourne : la Cinquième République, désormais, n'est plus dirigée par son inspirateur et c'est à l'électorat de choisir son successeur.
Conformément à la Constitution française, c’est Alain Poher, alors président du Sénat, qui succède à Charles de Gaulle en tant que président de la République par intérim. Une élection présidentielle anticipée doit avoir lieu le 1er juin 1969. À la suite du raz de marée gaulliste de l'élection anticipée qui avait suivi Mai 68, le courant politique majoritaire de la France est la droite : l’Union pour la défense de la République (UDR), formation gaulliste, soutenue par les Républicains indépendants, libéraux menés par le populaire Valéry Giscard d'Estaing, détient la majorité absolue au Parlement (60 % des sièges de l’Assemblée nationale après sa dissolution par de Gaulle en réponse à la crise de mai 68 durant laquelle les partis de gauche, tenus pour partiellement responsables des événements, avaient essuyé leur plus sévère défaite depuis le scrutin de 1958).
La majorité en place ne tarde guère à trouver son candidat : Georges Pompidou, ancien premier ministre de de Gaulle a su, depuis son éviction au profit de Couve de Murville, se faire soutenir par l’ensemble de la majorité parlementaire (avec, notamment, le soutien indéfectible de Giscard d’Estaing).
En l’absence de la droite nationaliste1, Pompidou est alors concurrencé dans les sondages par Poher, qui, soutenu par la formation de centre droit Progrès et démocratie moderne, ne semble pas décidé à lui abandonner l’Élysée. La gauche, qui avait pourtant réussi à se rassembler derrière la candidature de François Mitterrand en 1965, est quant à elle victime des divisions en son sein, les socialistes de la SFIO refusant de collaborer avec le Parti communiste français.
Alain Poher ne parvient pas à imposer une crédibilité que l'ancien premier ministre Pompidou possède. Ce dernier sait se montrer habilement à la fois différent et fidèle au Général de Gaulle. Il s'affiche entre Giscard d'Estaing, libéral, moderne et les gaullistes historiques, promettant une certaine libéralisation économique, dans le maintien de l'ordre national. La campagne de Gaston Deferre, qui s'affiche dans un duo avec Pierre Mendès France qui serait son premier ministre, tourne vite à l'échec : technique, rappelant la Quatrième République, Pierre Mendès France pourtant populaire un an auparavant, contraste avec Gaston Deferre dont la candidature manque de crédibilité et de charisme. Cet échec contraste avec la faconde et l'accent du candidat communiste, Jacques Duclos, et avec l'agitation brillante de l'innovant PSU, Michel Rocard. Les autres candidats sont le trotskiste Alain Krivine, étudiant d'extrême gauche sous les drapeaux et l'entrepreneur indépendant Louis Ducatel.
La campagne de Gaston Deferre se termine en désastre électoral pour la SFIO, largement distancée par le PCF et presque rattrapée par le PSU. Seul Poher peut désormais vaincre Pompidou. Si Deferre vote pour lui, au soir du premier tour, Duclos indique à ses électeurs que les deux candidats en lice, dont aucun n'est de gauche, sont « bonnet blanc et blanc bonnet » et doivent donc être renvoyés dos à dos par un vote blanc ou une abstention. Dès lors, Poher ne peut plus gagner.
JACQUES DUCLOS (1895-1975)
 Fils d'Antoine Duclos (artisan-charpentier) et d'une mère couturière, Jacques Duclos est apprenti-pâtissier dès l'âge de douze ans. Il reste avide de lecture pendant toute son adolescence.
Fils d'Antoine Duclos (artisan-charpentier) et d'une mère couturière, Jacques Duclos est apprenti-pâtissier dès l'âge de douze ans. Il reste avide de lecture pendant toute son adolescence.
En 1915, pendant la grande guerre, il sert dans l'armée française et participe à la bataille de Verdun. Blessé, vite soigné, il est redirigé vers le Chemin des Dames où il est fait prisonnier. Son frère aîné Jean laisse sur les champs de bataille son nez et un œil.
Il adhère au Parti communiste dès sa fondation en 1920. Un an plus tard, il devient le secrétaire de la section du 10e arrondissement de Paris tout en prenant des responsabilités à l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC). Il exerce son métier de chef-pâtissier jusqu'en 1924
Membre du comité exécutif de l'Internationale communiste. Député de Paris dès 1926, il est vice-président de la Chambre du Front populaire (1936). Sous l'Occupation, il est l'un des organisateurs de l'action clandestine du Parti communiste, et sa tête est mise à prix par les Allemands. De 1946 à 1958, il est réélu à toutes les consultations et préside à l'Assemblée le groupe parlementaire communiste. Le 28 mai 1952, victime d'une manœuvre policière (on l'accuse d'avoir transporté des pigeons voyageurs), il est arrêté au moment des manifestations organisées par la C.G.T. et le P.C.F. contre la venue à Paris du général Ridgway, emprisonné, puis libéré à la suite d'un important mouvement populaire de protestation. Il perd son siège de député en novembre 1958, mais il entre au Sénat en avril 1959 où il préside, jusqu'à sa mort, le groupe communiste.
Candidat du Parti communiste à la présidence de la République en 1969, il recueille 4,8 millions de voix. Tribun redoutable, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels plusieurs tomes de Mémoires, son histoire se confond avec celle de son parti dont il est devenu un leader historique. S'y étant engagé sans défaillance, il a pu déclarer, en juin 1969 : « J'ai autant de raisons d'être communiste qu'à vingt-quatre ans, et c'est ce qui éclaire ma vie. » En 1968, Duclos ne devait finalement pas s'opposer à la condamnation de l'intervention russe en Tchécoslovaquie. Il reçut en octobre 1971, à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire, l'ordre de Lénine « pour les grands services rendus au mouvement communiste et ouvrier international ».
Sources Wikipédia et Universalis
16:40 Publié dans Actualité, Biographie, PCF | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : présidentielles, pcf, jacques duclos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2017
Julian Grimau, la dignité humaine assassinée
Cathy Ceïbe, 19 Avril, 2013, L'Humanité
 Le 20 avril 1963, le dirigeant communiste est exécuté par un peloton franquiste au terme d’une parodie de justice. Sa réhabilitation reste d’actualité dans une Espagne qui ne veut pas se prononcer sur les crimes de la dictature. Une Espagne qui se refuse à solder les comptes du passé.
Le 20 avril 1963, le dirigeant communiste est exécuté par un peloton franquiste au terme d’une parodie de justice. Sa réhabilitation reste d’actualité dans une Espagne qui ne veut pas se prononcer sur les crimes de la dictature. Une Espagne qui se refuse à solder les comptes du passé.
Il est des matins de printemps qui n’en sont pas. Comme ce samedi 20 avril 1963, lorsqu’un peloton d’exécution franquiste perfore de trente balles Julian Grimau. Cinquante ans ont passé depuis l’assassinat du dirigeant communiste dans la prison de Carabanchel à Madrid. De ce côté-ci des Pyrénées, des rues et des cités populaires portent ce nom qui résonne encore dans la mémoire des républicains espagnols.
Grimau est un symbole de la répression de la dictature que la générosité d’une mobilisation mondiale ne parviendra pas à sauver. Ce 20 avril 1963, il est allé à la mort avec l’état d’esprit qui fut toujours le sien, « sans attendre d’autre récompense que la conscience tranquille de celui qui a fait son devoir devant sa classe, son peuple, son parti ».
Julian Grimau est né le 18 février 1911 à Madrid. C’est un jeune ouvrier typographe qui voit alors deux Espagne se défier : l’une, réactionnaire, oligarque, dévote, militariste ; l’autre, républicaine, progressiste, agnostique. Il choisit son camp.
 En 1931, il rejoint le Parti républicain démocratique fédéral. Le 18 juillet 1936, Franco déclare la guerre à la République. À l’automne, Julian Grimau adhère au Parti communiste d’Espagne (PCE) dont il deviendra, en 1937, secrétaire d’une brigade de police à Barcelone. À la fin de la guerre, il est contraint à l’exil. Il se réfugie alors à Cuba.
En 1931, il rejoint le Parti républicain démocratique fédéral. Le 18 juillet 1936, Franco déclare la guerre à la République. À l’automne, Julian Grimau adhère au Parti communiste d’Espagne (PCE) dont il deviendra, en 1937, secrétaire d’une brigade de police à Barcelone. À la fin de la guerre, il est contraint à l’exil. Il se réfugie alors à Cuba.
De retour en Europe, il participe à Prague, en 1954, au 5e Congrès du PCE, où il est élu membre du comité central que dirige Dolores Ibarruri, la Pasionaria. En 1962, il est élu secrétaire du Parti. Dans la clandestinité, Grimau assume cette lourde et dangereuse responsabilité à Madrid. Le pays, garrotté par le despote, est le théâtre de luttes sociales et ouvrières grandissantes.
Le 7 novembre 1962, il est arrêté dans un bus par deux membres de la police politique. Julian Grimau est alors transféré au sinistre siège de la direction générale de la sécurité (DGS). Pour ceux qui ont foulé la Puerta del Sol, la place épicentre de la capitale, là où se trouve le kilomètre zéro des routes espagnoles, il s’agit désormais du siège du gouvernement de la région autonome de Madrid, dirigé par la droite du Parti populaire (PP). En ce lieu, rien ne rappelle qu’on y a frappé et torturé. Que les cris sortaient des soupiraux. Que les bourreaux ont frappé et défenestré Julian Grimau, sans le tuer. Aucune plaque à la mémoire des combattants de la liberté que l’on a voulu faire taire à jamais. Le PP, ex-Alianza popular fondé par Manuel Fraga, ministre de l’Information et du Tourisme de Franco qui osa déclarer que Grimau s’était jeté dans le vide de manière « inexpliquée », nie encore son terrible passé. Ou l’assume…
Le 18 avril 1963, Julian Grimau est traduit devant un conseil de guerre (procès no 1.601/62). Outre son « activité subversive et sa propagande illégale », on l’accuse de « crimes commis pendant la guerre civile » lorsqu’il dirigeait la tcheka (centre de détention politique) de la rue Barenguer à Barcelone. Une campagne médiatique alimentée par le régime vise à discréditer Grimau, à le faire passer pour « un délinquant de première grandeur au service d’une cause criminelle » : le communisme.
 Le dossier est vide, et les supposés crimes proscrits. Les manifestations de soutien, elles, gonflent en Europe et en Amérique latine. Digne et courageuse, son épouse, Angela, résiste pour leurs deux fillettes, en se battant pour sa libération. Plus de 800 000 télégrammes arrivent à Madrid pour que cesse la parodie de justice d’une cour martiale dont le « conseiller légal » n’est en possession d’aucun titre juridique ! La dictature veut bâillonner cet homme, image de la lutte antifasciste, dépositaire de l’Espagne, légale, républicaine et égalitaire. Julian Grimau est un héros qu’il faut tuer.
Le dossier est vide, et les supposés crimes proscrits. Les manifestations de soutien, elles, gonflent en Europe et en Amérique latine. Digne et courageuse, son épouse, Angela, résiste pour leurs deux fillettes, en se battant pour sa libération. Plus de 800 000 télégrammes arrivent à Madrid pour que cesse la parodie de justice d’une cour martiale dont le « conseiller légal » n’est en possession d’aucun titre juridique ! La dictature veut bâillonner cet homme, image de la lutte antifasciste, dépositaire de l’Espagne, légale, républicaine et égalitaire. Julian Grimau est un héros qu’il faut tuer.
« Ne vous y trompez pas. Ils me fusilleront sans aucune hésitation : ma mort est décidée depuis longtemps. À tous, je vous demande une chose : maintenez votre unité, continuez la lutte pour la liquidation définitive du franquisme », dit-il à ses compagnons de détention avant de tomber sous les balles. Paris, et d’autres capitales grondent de colère contre ce crime d’État. Dans l’Humanité, le poète et communiste espagnol Marcos Ana, qui a passé vingt-trois ans dans les geôles franquistes, déclare : « Avec Julian Grimau, on a voulu assassiner l’esprit même de liberté, de la dignité humaine. »
En 1964, Léo Ferré lui rend hommage : « L’heure n’est plus au flamenco. Déshonoré, Mister Franco. Nous vivons l’heure des couteaux. Nous sommes à l’heure de Grimau. » Un an plus tard, il reçoit à titre posthume la médaille d’or du Conseil mondial de la paix. Cinquante ans plus tard, la réhabilitation de Julian Grimau est toujours d’actualité : l’Espagne, atrophiée par le silence, se refuse à solder les comptes du passé.
Vers la réhabilitation ? En 2006, une brèche s’est ouverte. Sur proposition du groupe mixte et particulièrement de la Gauche unie, le Sénat espagnol a approuvé une motion dans laquelle elle enjoignait le gouvernement socialiste de « procéder à la réhabilitation citoyenne et démocratique de la figure de Julian Grimau ». Car, officiellement, le dirigeant communiste est toujours considéré comme un criminel. À l’époque, tous les groupes avaient voté la motion, à l’exception du Parti populaire. L’initiative est tombée aux oubliettes de l’histoire. L’exécution de Julian Grimau fut pourtant un crime d’État. Un parmi des milliers d’autres perpétrés par la dictature de Franco. L’anniversaire de son assassinat est l’occasion pour les organisations mémorielles d’exiger des autorités l’annulation de tous les procès et sentences prononcés par les conseils de guerre et les tribunaux spéciaux du franquisme. C’est à leurs yeux une dette non soldée à l’égard des victimes. C’est aussi une question politique, éthique et de justice.
10:38 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Espagne, Guerre d'Espagne, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grimau, espagne, fusillé, communiste |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2017
1917, une histoire soviétique
Jean-Paul Piérot, l'Humanité
En 1919, les troupes cosaques des Blancs lors de la guerre civile, en Sibérie. Bettman Archives/Getty Images
.Le centenaire de la révolution d’Octobre est l’occasion d’une riche production éditoriale. Parmi les nombreux ouvrages, ceux des deux historiens Marc Ferro et Jean-Jacques Marie.
Les Russes. L’esprit d’un peuple, éditions Tallandier, 222 pages, 19,90 euros. La Guerre des Russes blancs. 1917-1920 de Marc Ferro. de Jean-Jacques Marie. éditions Tallandier, 528 pages, 24,90 euros
L’histoire est une matière à risques. Marc Ferro ressuscite des souvenirs de jeunesse, lorsqu’il préparait, en URSS, sa thèse de doctorat au début des années 1960. Le livre, écrit à la première personne, fourmille d’anecdotes qui traduisent l’esprit d’une époque, une ambiance politique, la vie quotidienne. Le temps est alors à l’espoir : la dénonciation en 1956 par Nikita Khrouchtchev du culte de la personnalité de Staline, les premiers pas de la détente, la consommation participent de la confiance qu’incarne Youri Gagarine, héros de la conquête spatiale. Les zones d’ombre maintenues sur certaines pages du passé ne sont pas une spécialité soviétique – l’histoire du colonialisme français ne manque pas d’exemples, de Sétif à Madagascar – mais à Moscou, on continue de gommer des photos les personnages « négatifs ». Khrouchtchev lui-même n’y échappera pas.
En 1991, l’URSS s’effondre dans une quasi-indifférence de la population
Marc Ferro aborde le débat sur les deux révolutions de 1917, celle de février, qui entraîne la chute du tsar, et celle d’octobre, qui consacre l’accession du parti bolchevik au pouvoir. « La haine de l’autocratie, explique Marc Ferro, la misère du plus grand nombre constituaient un mélange explosif. » Privés de terres, sortis depuis un demi-siècle du servage, les paysans commencèrent à se saisir des propriétés. Dans l’armée, les galonnés qui envoyaient les soldats à la mort voulaient perpétuer l’ancien ordre. Lénine fut l’un des seuls dirigeants à « encourager la violence venue d’en bas » pour que « la dissolution de l’ancienne société s’accomplisse », ajoute l’historien. « À force de s’interroger sur la filiation entre Lénine et Staline, on a fini par ne plus prendre en considération l’appartenance de tous ces théoriciens à un courant plus large, qui entendait substituer l’État savant à l’État-nation ou à l’État de droit », estime Marc Ferro.
Quand bien des années plus tard, en 1985, Mikhaïl Gorbatchev lance le chantier de la perestroïka, a-t-il en vue de faire une « révolution sous la table » car l’opinion en savait encore moins qu’elle en savait auparavant sur les plans du régime soviétique ? La suite est connue : en 1991, l’URSS s’effondre dans une quasi-indifférence de la population. Le nouvel homme fort du Kremlin, Boris Eltsine, se soumet entièrement aux néolibéraux. Libération des prix, spoliation de l’épargne, hyperinflation ont paupérisé l’ensemble de la population. Une totale humiliation. Il n’y a pas d’autres explications à l’adhésion quelques années plus tard au discours nationaliste et autoritaire de Vladimir Poutine.
Mais revenons à l’automne 1917, quand le tout jeune gouvernement bolchevique est confronté à la guerre intérieure déclenchée par les généraux monarchistes déterminés à restaurer l’ordre ancien. Les conjurés – les Dénikine, Koltchak, Wrangel parmi les plus célèbres – sont appuyés par les forces occidentales d’intervention de l’Entente. Les alliés sont convaincus qu’un danger les menace, qui ne viendrait pas de l’extérieur, mais de l’intérieur de leurs propres pays, sous la forme d’une révolution sociale. S’ensuivront trois années effroyables pour les peuples de l’ex-empire des Romanov. La Sainte Alliance antibolchevik échouera à écraser la révolution. Le livre de Jean-Jacques Marie déroule un récit passionnant sur cette période trop méconnue de l’histoire de l’Union soviétique.
Cette tentative de restauration, qui sera plus tard le thème de l’épopée romanesque le Don paisible, de l’écrivain soviétique Mikhaïl Cholokhov, part du sud de la Russie. Les Cosaques forment le fer de lance de cette « armée des volontaires » mise sur pied par un triumvirat comprenant les généraux Kornilov, qui a déjà ourdi une tentative de putsch contre le gouvernement provisoire, Alexeïev et Dénikine.
La férocité de la guerre civile, explique Jean-Jacques Marie, a de multiples causes. La Première Guerre mondiale, en envoyant des millions d’hommes au carnage, a enlevé tout prix à la vie humaine. « Elle a accumulé dans le cœur des victimes une haine profonde pour ceux qui en étaient à leurs yeux les coupables. » Les ouvriers paysans et soldats exècrent les « bourgeois » ; les soldats paysans détestent les officiers qu’ils assimilent aux propriétaires. Le mépris des représentants de l’ancien régime vaincu vis-à-vis du peuple est immense. Pourquoi les Blancs ont-ils perdu ? L’auteur pointe l’absence de réponses aux aspirations sociales. Les chefs Blancs, souligne Jean-Jacques Marie, ne voient les bolcheviks que comme des meneurs, d’une « populace » méprisée et jamais n’évoquent les mesures prises par leurs adversaires : la socialisation de la terre, le droit de vote pour les femmes, la constitution d’une banque centrale, les nationalisations, l’interdiction du travail de nuit dans l’industrie pour les femmes et les jeunes de moins de 16 ans, l’annulation de la dette
18:47 Publié dans Livre, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, révolution, histoire, 1917 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |