07/06/2013
MARCEL PAUL ENFANT ET MINISTRE COMMUNISTE DE LA REPUBLIQUE
Enfant trouvé le 12 juillet 1900 dans le XIVe arrondissement de Paris où il avait été abandonné, il commence à travailler à l'âge de 13 ans comme valet de ferme dans la Sarthe. Il milite à 15 ans dans les Jeunes Socialistes, contre la guerre.
Mobilisé dans la marine, il participe à la révolte des équipages de Brest, puis à celle des marins qui refusent de faire fonctionner la centrale électrique de Saint-Nazaire contre les ouvriers en grève.
À sa démobilisation, il s'installe tout d'abord à Saint-Quentin, dans l'Aisne, où il travaille dans le bâtiment et commence à exercer une activité syndicale. Il est ensuite embauché comme électricien à la Société des transports en commun de la région parisienne. En 1923, il adhère au parti communiste.
De 1931 à 1936, il occupe le poste de secrétaire général de la Fédération des services publics, hospitaliers, éclairage et force motrice (CGTU). Il est nommé ensuite secrétaire général adjoint, puis secrétaire général (en 1937) de la Fédération réunifiée de l'éclairage1. En 1932, il est violemment agressé à la sortie d'une réunion syndicale du personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Marseille. Une infirmière qui l'accompagne, Edmée Dijoud, est tuée. Devenu proche de Maurice Thorez, il est présenté par le PCF aux élections municipales de 1935 dans le XIVe arrondissement de Paris, où il est élu, ainsi que Léon Mauvais.
En 1938, il se rend en Espagne et en Tchécoslovaquie au nom de la CGT.
En 1939, il est mobilisé dans l'infanterie, car la marine refuse son incorporation. Après la signature du pacte germano-soviétique, il est exclu, ainsi que les autres communistes, de la direction de la Fédération de l'éclairage (Clément Delsol le remplace à la tête de la fédération dite « légale »). Fait prisonnier, il s'évade deux fois.
Il rejoint la Bretagne, où il occupe avec Auguste Havez la fonction de responsable inter-régional. Il s'occupe alors de ramasser des armes et des explosifs pour constituer des dépôts, puis, sur ordre de la direction du parti, revient à Paris en novembre 1940 tout en suivant les actions dans l'ouest jusqu'en janvier 1941. Très actif dans le milieu de l'éclairage et des services publics, il s'investit dans la mise sur pied de comités populaires dans la région parisienne.
Investi également dans l'Organisation spéciale, il apprend, à partir de juillet 1941, le maniement des explosifs avec France Bloch-Sérazin et organise en août 1941,un attentat manqué contre un train officiel allemand2.
Dénoncé, il est arrêté en novembre 1941. Détenu au commissariat, puis à l'hôpital de Saint-Denis où il tente de se suicider, il est ensuite transféré à la prison de la Santé. Jugé en février 1943 par la section spéciale, il est condamné à quatre ans de prison.
À l'été 1943, il est transféré, avec d'autres détenus, à la centrale de Fontevrault. Livré en février 1944 aux Allemands, Marcel Paul tente une nouvelle fois de s'évader. Il est déporté le 27 avril 1944 à Auschwitz, où un matricule lui est tatoué. Le 14 mai, il est transféré à Buchenwald avec les hommes de son convoi.
Dans le camp, il devient l'un des chefs de la Résistance clandestine, au sein du « comité des intérêts français ». Il devient l'un des cinq membres du bureau et peut décider de l'affectation des détenus aux postes de travail. Il sauve ainsi de nombreux déportés français, dont Marcel Dassault.
Rapatrié en priorité avec des personnalités, il reste peu de temps à Paris et repart pour Buchenwald pour s'occuper du retour des autres déportés.
De retour à Paris, Marcel Paul entre au Comité central du PCF, élu lors du Xe congrès de juin 1945. Il reprend ses activités syndicales et est nommé membre de l'Assemblée consultative, où il intervient le 3 août en faveur de la nationalisation du gaz et de l'électricité.
MINISTRE DE LA REPUBLIQUE
 Député de la Haute Vienne de l‘Assemblée constituante, il est nommé ministre de la production industrielle le 21 novembre 1945, dans le gouvernement de Charles de Gaulle, succédant à Robert Lacoste, il reste à ce poste dans les gouvernements de Félix Gouin et de Georges Bidault, jusqu'en décembre 1946. Le 2 décembre 1945, il vote la nationalisation de la Banque de France et des organismes de crédit.
Député de la Haute Vienne de l‘Assemblée constituante, il est nommé ministre de la production industrielle le 21 novembre 1945, dans le gouvernement de Charles de Gaulle, succédant à Robert Lacoste, il reste à ce poste dans les gouvernements de Félix Gouin et de Georges Bidault, jusqu'en décembre 1946. Le 2 décembre 1945, il vote la nationalisation de la Banque de France et des organismes de crédit.
Le 27 mars 1946, il propose la nationalisation de l'énergie et organise la création d'EDF-GDF, qui est votée le 8 avril 19463. Il fait de la nouvelle entreprise publique une forteresse syndicale en organisant le statut du personnel. En tant que ministre de la Production industrielle, il dépose, le 15 janvier, un projet de loi relatif au personnel des exploitations minières et assimilées, plusieurs projets sur les élections aux Chambres de métiers et, le 20 avril, un projet portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur. Le 19 avril 1946, il vote pour l'adoption de la Constitution et le 24 avril pour la nationalisation des sociétés d'assurance.
En novembre 1946, il est élu à l'Assemblée nationale et nommé membre de la Commission de production industrielle. Il quitte le ministère en décembre 1946. Après un mois d'un gouvernement socialiste homogène, les ministres communistes sont rappelés en janvier 1947, mais pas Marcel Paul. À partir de janvier 1947, Marcel Paul reprend la tête de la fédération CGT de l'éclairage, fonction qu'il occupera jusqu'en 1966, de fait jusqu'en 1963.
En mai 1947, le gouvernement socialiste de Paul Ramadier écarte les ministres communistes. En février 1947, il devient président du Conseil central des œuvres sociales (CCOS) d'EDF-GDF, où il reste jusqu'à la dissolution de l'organisation par le gouvernement de René Pleven, le 17 février 1951. Le lendemain, la police envahit les locaux du CCOS, 22 rue de Calais, Paris 9e, et en chasse le personnel4.
MILITANT SYNDICAL
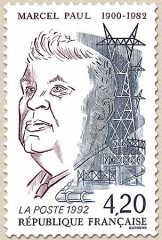 Voulant se consacrer plus totalement à sa mission syndicale, il démissionne de son mandat de député le 20 avril 1948. Il n'est pas candidat aux élections de 1951. En 1952, il fonde avec le colonel Manhès la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), dont il est président jusqu'à sa mort.
Voulant se consacrer plus totalement à sa mission syndicale, il démissionne de son mandat de député le 20 avril 1948. Il n'est pas candidat aux élections de 1951. En 1952, il fonde avec le colonel Manhès la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), dont il est président jusqu'à sa mort.
En 1964, il n'est pas réélu au Comité central du Parti communiste, à la suite de divergences concernant la reprise des œuvres sociales d'EDF-GDF qu'il avait créées. Depuis 1951, la gestion en est devenue patronale et le gouvernement met comme condition à la reprise de l'activité par les syndicats l'éviction de Marcel Paul, ce que la direction fédérale se résout à accepter en 1962.
Il est nommé officier de la Légion d'honneur5 en avril 1982. À l'issue de la cérémonie du 11 novembre 1982, place de l'Étoile à Paris, il est pris d'un malaise fatal. Il meurt chez lui quelques heures plus tard.
Source Wikipédia
18:28 Publié dans Biographie, Libération, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel paul, déportation, ministre, edf, gdf, ccas, résistance, concentration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
16/05/2013
Marcel Trillat: "Tant que l’Huma est là, il y a de l’espoir"
 Urgence pour l'Humanité Féru d’histoire, Marcel Trillat, journaliste et documentariste, demeure attaché à l’Humanité pour la parole qu’elle donne à la classe ouvrière et aux intellectuels.
Urgence pour l'Humanité Féru d’histoire, Marcel Trillat, journaliste et documentariste, demeure attaché à l’Humanité pour la parole qu’elle donne à la classe ouvrière et aux intellectuels.
L'Humanité et l'Humanité Dimanche sont en grand danger. Des difficultés de trésorerie les menacent gravement. Pour faire face à cette situation, l'Humanité et ses équipes font appel à leurs lectrices et lecteurs, aux organisations progressistes et démocratiques, à toutes les personnes attachées au pluralisme des idées et de la presse
L’Humanité est dans une situation de trésorerie très délicate. Comment réagissez-vous à l’idée qu’elle soit menacée de disparaître?
Marcel Trillat. Mes raisons d’être attaché à l’Huma sont multiples et évidentes. D’abord, c’est le journal fondé par Jaurès, pour qui j’ai toujours eu une grande admiration. Ce titre est né avec l’apport de la classe ouvrière, à laquelle il était d’abord destiné, mais aussi avec celui des grands intellectuels de l’époque. C’était quelque chose, dans le contexte ! Mais je songe également à l’Huma durant la Seconde Guerre mondiale, clandestine, avec ses exemplaires ronéotés avec les moyens du bord, par des gens qui risquaient leur vie. Tout cela a une valeur sentimentale. Et puis, je suis né à la politique pendant la guerre d’Algérie, j’avais quatorze ans en 1954. Avec d’autres jeunes, on se battait comme des chiens contre les horreurs de cette guerre. Et je me souviens de l’Huma paraissant avec des grands espaces blancs sur la première page, à l’emplacement d’articles censurés parce que jugés trop fraternels. Nous avions eu des parents résistants, nous faisions le rapprochement. Cette période d’horreurs, de tortures en Algérie m’a définitivement marquée. Et l’Huma, malgré des moments moins glorieux, dus aux aveuglements du Parti communiste à une époque, participe de cet imaginaire-là.
Pour la réalisation de vos films historiques, il vous a été précieux de consulter ses archives?
Marcel Trillat. Oui, je m’y suis replongé souvent! Mais mon attachement a aussi des raisons plus actuelles. Je lis tous les journaux. Je cherche mon miel un peu partout, il faut admettre que j’en trouve de moins en moins. Qu’est-ce qui resterait comme journal de gauche s’il n’y avait plus l’Huma?
Justement, que serait, selon vous, le monde médiatique sans l’Humanité?
Marcel Trillat. Ce serait un véritable désastre. Certes, le manque de moyens se ressent parfois à la lecture. Je me mets parfois à votre place, me disant que ne plus avoir les moyens de multiplier les reportages doit être un crève-cœur. Mais, malgré cela, vous avez réussi à continuer à faire un grand journal. En faisant participer de grands intellectuels, notamment. Cela apporte énormément de choses. Je me jette dessus! Et puis, j’adore le supplément Cactus du jeudi et le suivi des grandes luttes sociales. L’Huma est souvent désespérément seul pour défendre ceux dont la vie est en train d’être bousillée par la finance. L’Huma leur donne la parole et explique pourquoi tout cela est insupportable et comment les choses pourraient se passer autrement. Ça, c’est irremplaçable! Oui, pour tous les gens qui se battent aujourd’hui, l’Huma est irremplaçable. Laisser disparaître ce journal aujourd’hui, ce serait comme leur mettre un bâillon sur la bouche. Tant que l’Huma est là, il y a de l’espoir!
18:40 Publié dans Actualité, L'Humanité, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'humanité, souscription pour l'humanité, marcel trillat |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
08/05/2013
LA BATAILLE DE STALINGRAD
 La bataille de Stalingrad a principalement consisté en le siège de cette ville du sud de la Russie (de nos jours appelée Volgograd) par les Allemands et leurs alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale.
La bataille de Stalingrad a principalement consisté en le siège de cette ville du sud de la Russie (de nos jours appelée Volgograd) par les Allemands et leurs alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale.
La capitulation des troupes allemandes le 2 février 1943 devant les forces soviétiques est considérée comme le début de la fin pour les forces de l'Axe, qui y perdirent un quart de leurs armées et l'initiative sur le front Est ; l'espoir changea de camp, le combat d'âme.
La bataille de Stalingrad se déroula de septembre 1942 à février 1943. Stalingrad était en 1942 la première ville industrielle de l'URSS.
Elle comptait 600000 habitants et se trouvait de 100 à 280 mètres d'altitude. Elle s'étendait sur plus de 60 kilomètres carrés sur la rive droite de la Volga.
Elle se trouvait au centre d'un dense réseau de vois ferrées, et possédait d'immenses usines comme Barricade, Octobre Rouge, et la plus grande usine de tracteurs de l'URSS(qui produisait depuis 1941 les chars T-34 de l'Armée Rouge, supérieurs aux Panzers). C'était un noeud de communication important entre les réserves de pétrole du Caucase(c'est en partie pour s'accaparer ce pétrole que Hitler déclencha l'offensive contre l'URSS en juin 1941) et le reste de l'URSS.
 UNE BATAILLE GIGANTESQUE
UNE BATAILLE GIGANTESQUE
Hitler voulait que ses armées prennent Stalingrad pour protéger le flanc gauche de l'offensive de l'été 1942 de la Wehrmacht en direction du Caucase.
Les Russes disposaient à l'origine de la LXIIème armée du général Tchouïkov, soit 160 000 hommes. Les Allemands avaient mobilisé la VIème armée du général Von Paulus, appuyée par des formations des pays satellites, soit 270 000 hommes.
Hitler se sépara de Von Brauchitsch, et prit lui-même, de son QG de Vinnitsa(au sud-ouest de Kiev), la direction effective de l'OKH et de l'armée de terre. Le 28 juin 1942, la nouvelle offensive fut déclenchée. Les forces du maréchal Von Bock comptaient alors 76 DI, 10 Panzers, 8 DI, soit 900 000 hommes, 1 200 chars et canons d'assaut, 17 000 canons et 1 640 avions. Timochenko, Malinovski et Golikov possédaient 1 715 000 hommes, 2 300 chars, 16 500 canons, et 758 avions. Au début de l'été, les Allemands traversèrent la steppe Russe.
Les Soviétiques, pour stopper l'avance des Allemands, pratiquèrent la politique de la "terre brûlée"(destruction de barrages pour inonder certaines zones, incendies de forêts,. . . ).
Le 11 juillet 1942, la levée en masse fut décrétée. Le 12, les éléments mécanisés du groupe d'armées B atteignirent les abords de la ville.
Le 13 juillet 1942, les Soviétiques décidèrent de créer des passages et des ponts sur les lignes d'eau, d'évacuer une partie de la population et de créer des détachements de partisans.
Le 15, une quatrième ligne de défense(la ville était protégée depuis 1941 par trois lignes de défense), d'une longueur de 50 kilomètres, fut construite, avec l'aide de 180 000 civils.
Le 17 juillet 1942, 270 000 hommes de la VIème armée de Von Paulus, appuyés par 3 000 canons, 500 chars et 1 200 avions, attaquèrent les LVIIème et LVIIIème armées Soviétiques, qui comptaient 160 000 hommes, appuyés par 2 200 canons, 400 chars, et 700 appareils.  La bataille, qui eut lieu au nord, dans l'isthme entre le Don et la Volga, dura 6 jours. Stalingrad semblait perdue. Mais la ville tint pendant deux mois.
La bataille, qui eut lieu au nord, dans l'isthme entre le Don et la Volga, dura 6 jours. Stalingrad semblait perdue. Mais la ville tint pendant deux mois.
Staline envoya alors des divisions du nord vers Stalingrad, et nomma deux de ses meilleurs généraux, Andrei Ieremenko et Alexandre Vassilevski, auxquels il associa un commissaire politique, Nikita S. Khrouchtchev.
Le 23 juillet 1942, Hitler ordonna à ses troupes de faire route vers Stralingrad. Peu de temps avant l'offensive Allemande la Wehrmacht bombarda massivement la ville. Les usines furent détruites, ainsi que les voies de chemin de fer par lesquelles arrivaient le ravitaillement.
En août 1942, la VIème armée Allemande, commandée par le général Friedrich Paulus, et la IVème armée blindée, dirigée par le feld-maréchal Fedor Von Bock, lancèrent une offensive contre Stalingrad, qui était défendue par le général soviétique Tchouikov.
Le 5 septembre, les divisions de Paulus entrèrent dans les faubourgs de la ville.  LA VILLE RESISTE
LA VILLE RESISTE
Les combats furent acharnés, on se battait dans un tas de ruines.
A chaque fois que quelqu'un gagnait du terrain il fallait qu'il vide toutes les caves, les caches de chaque maison, ou l'ennemi pouvait se cacher. Cependant les forces russes connaissaient le terrain et étaient aidées par les ouvriers. Elles disposèrent des pièges dans toute la ville(les Russes cachaient par exemple des tourelles de tanks sous les décombres et tiraient lorsque les Allemands s'approchaient assez près).
Les Russes possédaient aussi de nombreux tireurs d'élite, bien entraînés(certains tireurs d'élite russes réussirent à tuer au cours de la bataille, à eux seuls, plus de 150 Allemands).
De plus les Allemands étaient mal équipés pour l'hiver(certains Allemands prenaient même les vêtements des morts Russes).
Le 5 octobre 1942, Staline réussit, grâce à l'aviation et à la flotille de la Volga, à envoyer 200 000 hommes aux assiégés, dont une division d'élite de la Garde. Le 15 octobre 1942, les troupes Allemandes réussirent à s'emparer de l'usine de tracteurs et d'une bande de 2,5 kilomètres sur la Volga.
Le 11 novembre 1942, les Allemands prirent la partie sud d'Octobre Rouge et un nouveau secteur du fleuve, ce qui scinda la LXIIème armée en trois éléments.
Le 14 novembre, la Volga commença à être prise par les glaces. A ce moment-là, la Wehrmacht alignait sur l'ensemble du front de l'Est 6 300 000 hommes, 70 000 canons, 3 400 chars et canons d'assaut, et 1 700 avions de combat. L'Armée Rouge alignait 6 100 000 hommes, 77 000 canons, 7 000 chars et 3 200 appareils. Fin octobre, les Allemands contrôlaient la majeure partie de la ville.
Les Russes étaient coincés entre les Allemands d'un côté, et la Volga de l'autre.
Les pertes furent énormes des deux côtés, mais les Russes résistèrent héroïquement pour laisser le temps aux renforts(de nouvelles divisions, des chars T-34, de la DCA, de l'artillerie) venant de l'arrière de se préparer et de se mettre en place pour effectuer une vaste contre-offensive.
A la mi-novembre, les Allemands parviennent à atteindre le fleuve. Mais la VIème armée était une force avancée dans le dispositif de l'offensive allemande et le 12 novembre 1942, les forces Roumaines, qui étaient chargées de la protection de la route du ravitaillement, furent attaquées par deux divisions blindées de l'Armée Rouge qui les obligea à battre en retraite. Paulus et ses 200000 hommes se retrouvèrent coincés dans Stalingrad. Les Russes, commandés par Joukov, décidèrent alors de lancer une contre-offensive en tenaille pour encercler les troupes allemandes et reprendre la ville.
Les Russes, commandés par Joukov, décidèrent alors de lancer une contre-offensive en tenaille pour encercler les troupes allemandes et reprendre la ville.
Le 19 novembre 1942, après avoir rassemblé des renforts en hommes et en matériel à l'est du Don et de la Volga, l'opération Uranus fut déclenchée par les Soviétiques(cette opération avait été conçue depuis le 13 septembre par Joukov et Vassilevski, et consistait à encercler les troupes Allemandes, en prenant en tenaille les points les plus faibles du couloir qui menait à Stalingrad ; les Soviétiques voulaient utiliser pour cette opération le front Sud-Ouest(GA du général Vatoutine), le front du Don(GA du général Rokossovski), et le front de Stalingrad(GA du général Ieremenko), soit 15 armées, dont une blindée et une aérienne.
Au nord-ouest de la ville, Rokossovski réussit à percer les lignes Allemandes à Kremenskaïa. Le lendemain, Ieremenko franchit la Volga, à 10 kilomètres au sud de Stalingrad. Vatoutine anéanti la IIIème armée Roumaine, la VIIIème armée Italienne, et la IIème armée Hongroise, en attaquant sur le Don, à la hauteur de Serafimovitch. Il approcha de Kalatch, et repoussa la contre-attaque du corps blindé H de la IVème armée blindée Allemande.
Ieremenko anéanti la IVème armée Roumaine, faisant 65 000 prisonniers.
Le 23 novembre 1942, les fronts Soviétiques opérèrent leur jonction à Kalatch, enfermant dans la poche de Stalingrad, large de 45 kilomètres, et profonde de 40, la VIème armée de Paulus et un CA de la IVème armée de Panzers, soit 22 divisions et 160 unités autonomes, c'est-à-dire 300 000 hommes.
Du 12 au 23 décembre 1942, les Allemands déclenchèrent l'opération Wintergewitter(Orage d'Hiver)qui avait pour but de rompre l'encerclement par le Sud-Ouest. Mais les Allemands furent arrêtés à 55 kilomètres de l'enclave.
Du 16 au 30 décembre 1942, les Russes déclenchèrent l'opération "Petite Saturne", et du 24 au 30 décembre 1942, eut lieu une contre-attaque Soviétique sur le groupe d'Armées Hoth. Fin janvier, les Soviétiques reprirent la ville quartier par quartier, appuyés par l'artillerie.
Les Soviétiques lançèrent alors une offensive en direction de Rostov, ce qui obligea Manstein, qui avait déjà perdu 16 000 hommes et 300 chars, à battre en retraite pour protéger ses flancs, et à abandonner sa tentative de dégagement de la VIème armée. Les Russes renforcèrent leur barrage aérien qui réussit à abattre 550 appareils Allemands.
La Lutwaffe n'arrivait à parachuter chaque jour que 20 à 50 tonnes de ravitaillement. Les chevaux furent mangés et la ration quotidienne de pain fut fixée à 100 grammes. Le 8 janvier 1943, Von Paulus refusa un ultimatum qui offrait une capitulation honorable.  LA DEFAITE ALLEMANDE
LA DEFAITE ALLEMANDE
Le 24 janvier, Von Paulus demanda à Hitler l'autorisation de capituler, qui lui fut refusée. Le 25 janvier 1943, les Allemands ne détenaient plus qu'une zone de 100 kilomètres carrés.
Le 26 janvier, à la suite d'une attaque de Rokossovski, la VIème armée dut se scinder en deux parties, un groupement Sud, dans le centre de la ville, sous les ordres directs de Paulus, et un groupement Nord, dans le secteur de l'usine Barricade et de l'usine de tracteurs, sous les ordres du général Strecker.
Les Russes déclenchèrent alors l'opération "Cercle". Le 27 janvier 1943, les Russes commençèrent à nettoyer les poches de résistance Allemandes. Les troupes allemandes étaient alors affamées et décimées.
Le 31 janvier 1943, le groupement Sud capitula.
Le 2 février 1943, Paulus(groupement Nord) se rendit au Haut Commandement Soviétique.
La Bataille de Stalingrad était finie. Les Soviétiques s'emparèrent de 60 000 véhicules, de 1 500 chars, et de 6 000 canons.
Les Russes firent 94 000 prisonniers(à peine 5% reviendront vivants après la guerre), dont 2 500 officiers, 24 généraux et Von Paulus lui-même, qui avait été récemment promu maréchal par Hitler. La bataille avait fait 140 000 tués, blessés et gelés. Les Russes avaient perdu 200 000 hommes.
LES CONSEQUENCES
La défaite de la bataille de Stalingrad marque pour les Allemands le début de la fin. Même si le général Paulus tenait les neuf dixièmes de la ville les forces de l'Axe n'ont rien pu faire contre l'extraordinaire force morale russe. À partir du 2 février 1943, les forces allemandes commencèrent à reculer et jamais ne reprirent l'avantage.
09:51 Publié dans Actualité, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stalingrad, urss, résistance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |







