02/01/2014
Républicain espagnol et communiste, Virgilio Peña a cent ans aujourd'hui...
Chronique de Jean Ortiz. Humble ouvrier agricole andalou, Virgilio est devenu un "héros" malgré lui, une "estrella" (une star) dit-il en pouffant de rire, grâce à son épopée et au documentaire Rouge miroir (Dominique Gautier et Jean Ortiz). La télé publique andalouse l'a programmé à plusieurs reprises. Le centenaire a une allure, un humour, une verve, une mémoire de jeune homme. Et des idéaux intacts."Toute ma vie j'ai été communiste. Et j'en suis fier."
Virgilio est né le deux janvier 1914, d'un père ouvrier agricole et d'une mère vendeuse de "churros", dans un village emblématique de la province de Cordoba: "Espejo" (en français: "miroir", cela ne s'invente pas), village à la blancheur rebelle, inondé d'oliviers et dominé par le château de la duchesse.
Son père, autodidacte, l'appela Virgile, du nom du poète latin qu'il lisait le soir, couché sur la paille. Lors du soulèvement paysan de 1918, la garde civile le tabassera jusqu'à le laisser "estropié". Il en mourra. Les reîtres bruleront ses livres (Virgile, Hugo...) sur la place du village.
Très jeune, Virgilio Peña (en espagnol, la "peña", c'est le rocher, cela ne s'invente pas non plus) adhère à la Jeunesse communiste, qui prône "la revolucion social".
Lorsque le 14 avril 1931 est proclamée en Espagne la République, le jeune ouvrier agricole ("jornalero") hisse le drapeau républicain au balcon municipal, "paseo de las Calleras". La République puis le Front populaire améliorent la vie, les conditions, jusque là esclaves, de travail des millions de "sans terre de l'époque". Même si la réforme agraire reste timide...Timide mais insupportable pour les grands propriétaires, les "caciques", l'oligarchie, l'Eglise, l'armée, la banque...
Lorsque le coup de force fascisant (le 18 juillet 1936) ensanglante le pays, le milicien Virgilio participe à la défense de son village andalou, puis rejoint le "bataillon Garcés". Il est aux premières lignes des combats acharnés de Pozoblanco, Villa del Rio, Lopera... L'intervention massive de Hitler et Mussolini, et l'hostilité antirépublicaine des gouvernements anglais et français, vinrent à bout de l'armée populaire.
La suite est connue. Internement honteux dans les camps, appelés "de concentration", du gouvernement Daladier et de la Troisième République: Barcarès et Saint-Cyprien.
En vidéo : un extrait de Rouge miroir de Dominique Gautier et Jean Ortiz
Envoyé à Bordeaux, Virgilio trime dans les vignobles puis à la construction de la "base sous-marine" allemande. Dès le début de 1942, il fait partie des premiers groupes de résistants. Le 19 mars 1943, il est arrêté et torturé par la police française puis livré aux nazis, qui le déportent en septembre 1943 à Buchenwald (matricule 40843), triangle rouge des "terroristes". Dans cet enfer, il organise la résistance du petit groupe d'Espagnols, et partage le même Block que Jorge Semprun. "Le 11 avril 1945, je suis né pour la deuxième fois. La résistance intérieure libère le camp, avant l'arrivée des Américains". Il en sort, la peau sur les os, en juin 1945, et rejoint Pau où il continue le combat antifranquiste avec ces camarades espagnols et français.
A cent ans, le jeune communiste Virgilio ne manque aucune manif, toujours un bon mot de "chispa" andalouse aux lèvres. Il y a des hommes "imprescindibles" (indispensables).
Publié par l'Humanité
11:44 Publié dans Actualité, Biographie, Guerre, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 2ème guerre mondiale, espagne, déportation, résistance, jean ortiz, franquisme, guerre civile espagnole, chroniques vénézuéliennes, jorge semprun |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2013
GHETTO JUIF EN POLOGNE : DES PHOTOS EXCEPTIONNELLES
Hugo Jaeger était l’un des photographes personnels d’Hitler dans les années 30 et un grand passionné des nouveaux films couleurs. Il a eu l’occasion d’utiliser cette nouvelle technologie de l’époque en prenant une série de photographies dans le ghetto de Kutno quelques mois après l’invasion de la Pologne par les nazis, une petite ville à quelques kilomètres du ghetto de Lodz, le deuxième plus grand de Pologne.
Le ghetto de Kutno comptait 8000 juifs et sera vidé dans sa totalité en 1942. Les juifs furent transportés au camp de Chełmno pour y être exterminés. Il resta à Kutno, les vieillards et les malades qui furent exécutés sur place.
Pourquoi les photographies de Hugo Jaeger sont uniques ?
 Parce que la plupart des photographies prises des juifs par le régime nazi dans les ghettos et connues jusqu’ici avait toujours pour but de montrer les juifs comme une race inférieure et infréquentable alors que celles présentées par Hugo Jaeger montrent des portraits bouleversants d’hommes, de femmes et d’enfants juifs qui pour la plupart sont en train de sourire.
Parce que la plupart des photographies prises des juifs par le régime nazi dans les ghettos et connues jusqu’ici avait toujours pour but de montrer les juifs comme une race inférieure et infréquentable alors que celles présentées par Hugo Jaeger montrent des portraits bouleversants d’hommes, de femmes et d’enfants juifs qui pour la plupart sont en train de sourire.
Les photographies très belles mais aussi très tristes nous paraissent insoutenables quand on prend conscience que ces personnes vivaient leurs derniers moments d’humanité. Intention de propagande nazi, perversité du photographe, résilience humaine des juifs du ghetto ? Tant de questions qui restent sans réponse. Ces photographies sont pour le moins poignantes.
Benjamin Siahou
19:10 Publié dans Monde, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghetto, pologne, photos, hugo jeager |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
04/10/2013
GIAP GENIE MILITAIRE VIETNAMIEN

Vo Nguyen Giap est un fils de mandarin. Il a été éduqué dans un lycée français et participe au mouvement communisme dès les années 1930. Il poursuit des études d’histoire, de droit et d’économie à Hué, puis à Hanoï.
En 1937, Giap devient professeur d’histoire à l’école Thang-Long à Hanoï et adhère au parti communiste en 1939. Lorsque celui-ci fut interdit, il s’enfuit en Chine, où il devient un des aide militaire d’Hô Chi Minch.
Après le coup de force des Japonais du 9 mars 1945, il profite de la disparition de l’administration française pour intensifier le recrutement de membres du Viet-Minh.
Vo Nguyen Giap est ministre, chargé des forces de sécurité, du premier gouvernement Hô Chi Minh. En 1946, il est nommé ministre de la Défense nationale de la république démocratique du Vietnam. C'est lui qui dirige les actions militaires contre les Français. Il est le vainqueur de la bataille de Diên Biên Phu (mai 1954).
En 1960, il prend la direction de la guérilla contre les Vietnamiens du Sud et des États-Unis. Il force les Américains à quitter le Sud du pays et participe à la réunification du Vietnam en 1975. Il démissionne du poste de ministre de la Défense en 1980, est exclu du bureau politique du parti communiste en 1982 tout en restant vice-premier ministre jusqu’en 1991.
Vo Nguyen Giap vivait retiré à Hanoï, mais s'exprimait régulièrement sur l'évolution politique de son pays. Vo Nguyen Giap est l’auteur de Guerre du peuple - Armée du peuple (François Maspero, 1967) et plus récemment a publié ses Mémoires (Anako, 2003-2004).
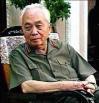
Vo Nguyen Giap Un entretien exclusif avec le général Vo Nguyen Giap, recueilli chez lui à Hanoï Hanoï, envoyée spéciale
À une trentaine de mètres en retrait de la rue Hoang Diêu, se situe la villa où vit le général Vo Nguyen Giap, entouré de sa femme Dang Bich Ha et de ses enfants et petits-enfants.
Un petit-fils passera la tête au cours de l’entretien que nous accorde le général, en uniforme, dans le salon du bâtiment " officiel " où s’entrecroisent les drapeaux. Sur les murs des photos de Hô Chi Minh et des messages de salutations brodés venus de tout le pays. Nous irons ensuite dans la villa familiale où nous attend Dang Bich Ha.
L’interview se déroule en français, langue que maîtrise parfaitement le général Giap. Ce sera aussi l’occasion d’exprimer son regret de ne jamais avoir pu aller en France.
" Je ne connais de Paris que son aéroport où j’ai fait escale quelques heures pour me rendre à Cuba "..
Il y a cinquante ans, la chute de Dien Bien Phu ouvrait la voie aux accords de Genève et à la fin de la première guerre du Vietnam. La France aurait, elle, pu éviter ce conflit ?
Général Giap. Nous avions proclamé notre indépendance le 2 septembre 1945 mais les colonialistes français ont voulu réimposer par la force leur domination sur la péninsule indochinoise.
De Gaulle avait déclaré à Brazzaville qu’il fallait restaurer le régime colonial par les forces armées. Nous avons toujours cherché à négocier pour éviter que le sang coule. Leclerc, envoyé à la tête de l’armée française pour reconquérir l’ancienne colonie s’est vite rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’une promenade militaire mais, a-t-il dit, du combat de tout un peuple. Leclerc était un réaliste.
Avec Sainteny, il faisait partie de ces gens raisonnables qui étaient en faveur de pourparlers, mais du côté du gouvernement français, on ne l’entendait pas ainsi. Nous avions conclu un accord en mars 1946 et fait une grande concession sur la Cochinchine, notre objectif final de l’indépendance totale et l’unité du pays.
À la mi-avril 1946, je participais à la conférence de Dalat. Les Français ne cachaient pas leur intention de rétablir leur domination en Indochine. Je leur ai dit alors clairement que l’ère des gouvernements généraux d’Indochine était close. J’ai quitté Dalat convaincu que la guerre était inévitable.
Une fois déclenchée, il y a eu pourtant quelques chances de l’arrêter. Le président Hô a plus d’une fois appelé le gouvernement français à négocier. Pour montrer notre bonne volonté, Hô Chi Minh n’ajourna pas sa visite en France pour participer à la conférence de Fontainebleau. Pendant ce temps, la situation ne cessait de s’aggraver, au Nord comme au Sud.
À la fin novembre 1946, les troupes françaises attaquèrent et occupèrent le port de Haiphong. Un mois plus tard, le général Morlière, commandant des troupes françaises au Nord de l’Indochine, lançait un ultimatum exigeant la présence française dans un certain nombre de positions, le droit de maintenir l’ordre dans la capitale, et le désarmement des milices d’auto-défense de Hanoi. Nous décidâmes de déclencher la résistance. 1946-1975, le Vietnam a connu trente ans de guerre.
Quelles ont été les différences entre les deux conflits ?
Général Giap. La guerre reste la guerre mais avec les Américains, ce fut autre chose, un conflit néocolonial avec d’abord une intervention de troupes américaines et, après, une guerre vietnamisée.
On a alors changé la couleur de peau des cadavres. Les Américains étaient naturellement sûrs de leur victoire et n’ont pas voulu entendre les conseils des Français qui avaient fait l’expérience de se battre contre les Vietnamiens. Les États-Unis avaient effectivement engagé des forces colossales et peu de gens, même parmi nos amis, croyaient en notre capacité de les vaincre. Mais les Américains n’avaient aucune connaissance de notre histoire, de notre culture, de nos coutumes, de la personnalité des Vietnamiens en général et de leurs dirigeants en particulier.
À MacNamara, ancien secrétaire à la Défense des États-Unis que j’ai rencontré en 1995, j’ai dit : " Vous avez engagé contre nous de formidables forces artilleries, aviation, gaz toxiques mais vous ne compreniez pas notre peuple, épris d’indépendance et de liberté et qui veut être maître de son pays. " C’est une vérité que l’histoire a de tout temps confirmée. Pendant 1 000 ans de domination chinoise, (jusqu’au Xe siècle), nous n’avons pas été assimilés.
Contre les B52, ce fut la victoire de l’intelligence vietnamienne sur la technologie et l’argent. Le facteur humain a été décisif. C’est pourquoi lorsqu’un conseiller américain du service de renseignements m’a demandé qui était le plus grand général sous mes ordres, je lui ai répondu qu’il s’agissait du peuple vietnamien. " J’ai apporté une contribution bien modeste, lui ai-je dit. C’est le peuple qui s’est battu ".
Brezjinski s’est aussi interrogé sur le pourquoi de notre victoire. Nous nous sommes rencontrés à Alger, peu après la fin de la guerre. " Quelle est votre stratégie ? " interrogea-t-il. Ma réponse fut simple : " Ma stratégie est celle de la paix. Je suis un général de la paix, non de la guerre. " J’ai aussi eu l’occasion de recevoir des anciens combattants américains venus visiter le Vietnam. Ils me posaient la question : nous ne comprenons pas pourquoi vous nous accueillez aujourd’hui si bien ? " Avant, vous veniez avec des armes en ennemis et vous étiez reçus comme tels, vous venez maintenant en touristes et nous vous accueillons avec la tradition hospitalière traditionnelle des Vietnamiens. " .
Vous avez fait allusion au fait que peu de personnes croyaient en votre victoire finale sur les Américains...
Général Giap. C’est vrai. C’est le passé, maintenant on peut le dire. Nos camarades des pays socialistes ne croyaient pas en notre victoire. J’ai pu constater lorsque je voyageais dans ces pays qu’il y avait beaucoup de solidarité mais peu d’espoir de nous voir vaincre.
À Pékin, où je participais à une délégation conduite par le président Hô, Deng Xiaoping, pour lequel j’avais beaucoup d’amitié et de respect, m’a tapé sur l’épaule en me disant : " Camarade général, occupez-vous du Nord, renforcez le Nord. Pour reconquérir le Sud, il vous faudra mille ans. " Une autre fois, j’étais à Moscou pour demander une aide renforcée et j’ai eu une réunion avec l’ensemble du bureau politique. Kossyguine m’a alors interpellé : " Camarade Giap, vous me parlez de vaincre les Américains.
Je me permets de vous demander combien d’escadrilles d’avions à réaction avez-vous et combien, eux, en ont-ils ? " " Malgré le grand décalage des forces militaires, ai-je répondu, je peux vous dire que si nous nous battons à la russe nous ne pouvons pas tenir deux heures. Mais nous battons à la vietnamienne et nous vaincrons.
" Licencié en droit et en économie politique, professeur d’histoire, vous n’aviez pas de formation militaire. Or, vous avez activement participé à l’élaboration de cette conception vietnamienne de la guerre. Comment êtes-vous devenu général ?.
Général Giap. Il aurait fallu faut poser la question au président Hô Chi Minh. C’est lui qui a choisi pour moi cette carrière militaire. Il m’a chargé de constituer l’embryon d’une force armée. Lorsque nous étions impatients de déclencher la lutte contre l’occupation française, Hô nous disait que l’heure du soulèvement n’était pas encore venue.
Pour Hô, une armée révolutionnaire capable de vaincre était une armée du peuple. " Nous devons d’abord gagner le peuple à la révolution, s’appuyer sur lui, disait-il. Si nous avons le peuple, on aura tout. " C’est le peuple qui fait la victoire et aujourd’hui encore si le parti communiste veut se consolider et se développer, il doit s’appuyer sur lui. .
Le Vietnam est aujourd’hui en paix, les conflits se sont déplacés sur d’autres continents. Que vous inspire la situation internationale ?
Général Giap. Nous sommes en présence d’une situation mondiale difficile dont on ne sait quelle sera l’évolution. On parle de guerre préventive, de bonheur des peuples imposé par les armes ou par la loi du marché. Il s’agit surtout pour certains gouvernements d’imposer leur hégémonie. C’est plutôt la loi de la jungle. On ne peut prédire ce qu’il peut se passer mais je peux dire que le troisième millénaire doit être celui de la paix.
C’est ce qui est le plus important. Nous avons vu de grandes manifestations pour le proclamer. La jeunesse doit savoir apprécier ce qu’est la paix. Le tout est de vivre et de vivre comme des hommes. Faire en sorte que toutes les nations aient leur souveraineté, que chaque homme ait le droit de vivre dignement..
L’Humanité fête son centenaire. Entre notre journal et le Vietnam, il y a une longue histoire de solidarité et de lutte commune pour la paix....
Général Giap. Nous avons beaucoup de souvenirs en commun avec l’Humanité et avec le PCF. Pendant les guerres française et américaine nous avons travaillé régulièrement avec les envoyés spéciaux et les correspondants du journal. Nos relations sont un exemple de solidarité et d’internationalisme.
J’adresse à tous nos camarades et à l’Humanité, mes salutations et mon optimisme pour un monde qui, à l’heure de la révolution scientifique et technique, doit permettre à chaque homme de ne plus souffrir de la faim et de la maladie.
Entretien réalisé par Dominique Bari. L'Humanité
15:58 Publié dans Actualité, Biographie, International, L'Humanité, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giap, viet nam, l'humanité, communiste |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |









