Dans la Grande Guerre Patriotique menée par l’Armée rouge contre les troupes d’invasion allemande, des dizaines de milliers de jeunes femmes se sont trouvées engagées au sein d’unités de combat – un cas unique dans l’Histoire.
C’est la première grande « bataille urbaine », au cours de laquelle a basculé le sort de la Seconde Guerre mondiale : Stalingrad. D’août 1942 à février 1943, les troupes soviétiques y affrontent les soldats allemands de l’opération Barbarossa, de pâté de maison en pâté de maison. Les soldats nazis sont tous des hommes, mais parmi les soldats de l’Armée Rouge, les uniformes cachent de nombreuses femmes.
Toutes les armées mobilisées lors de la Seconde Guerre mondiale, par les pays alliés comme par ceux de l’axe, sont masculines. Si les femmes ont commencé à être appelées en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, elles y restent cantonnées à des postes de défense anti-aérienne ou aux unités sanitaires. Elles ne sont jamais des combattantes.
Surnommées « les furies » par les nazis
Mais face à l’avancée spectaculaire des divisions d’Hitler sur le front de l’est, qui fera entre 25 et 28 millions de morts soviétiques, 100.000 femmes soviétiques s’engagent. Les unes resteront à l’arrière, tandis que les autres viendront les armes à la main en renfort des troupes décimées, d’abord en prenant part à des actions spontanées de guérilla ou de sabotage au sein de mouvements de partisans.
Dès 1942, elles sont même intégrées aux troupes de l’Armée Rouge et deviennent des soldates au même titre que les hommes. Combattantes au sol comme aviatrices, elles sont formées dans des écoles militaires pour femmes puis sont envoyées au front, donnant à l’armée soviétique une physionomie différente de toutes les autres. Adversaires redoutées, une des troupes d’aviatrices russes sera même surnommée « les furies » par les aviateurs allemands.
Lioudmila Pavlitchenko aurait tué 309 Allemands en un an
 L’entrée des femmes dans l’armée russe se fait dans la continuité de la politique d’égalité entre les hommes et les femmes dans le travail et dans les salaires menée par le régime soviétique, qui prônait même dans ses premières années l’abolition du mariage. En effet, proclamer la femme comme égale de l’homme faisait partie de l’idéologie communiste originelle.
L’entrée des femmes dans l’armée russe se fait dans la continuité de la politique d’égalité entre les hommes et les femmes dans le travail et dans les salaires menée par le régime soviétique, qui prônait même dans ses premières années l’abolition du mariage. En effet, proclamer la femme comme égale de l’homme faisait partie de l’idéologie communiste originelle.
Certaines de ces combattantes, comme Lioudmila Pavlitchenko, réputée pour avoir tué 309 Allemands en un an, devinrent célèbres et furent désignées comme héroïnes, martyrs ou ambassadrices du régime. Mais à la fin de la guerre, nombre d’entre elles ont été mal accueillies et mal vues pour avoir combattu.
Leur contribution aux différentes victoires de l’Armée rouge sera longtemps invisibilisée par le régime, avant qu’elles ne soient finalement réhabilitées.









 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg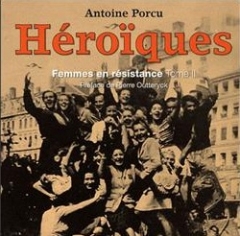 Jeune résistante communiste Nîmoise, Louisette Maurin est une de ces femmes qui en 1940 n'hésite pas à entrer en résistance. FTPF "légale" de Nîmes, elle participe aux activités du groupe dirigé par Jean Robert. Son activité s'étend des abords de la Camargue aux Cévennes.
Jeune résistante communiste Nîmoise, Louisette Maurin est une de ces femmes qui en 1940 n'hésite pas à entrer en résistance. FTPF "légale" de Nîmes, elle participe aux activités du groupe dirigé par Jean Robert. Son activité s'étend des abords de la Camargue aux Cévennes. 
