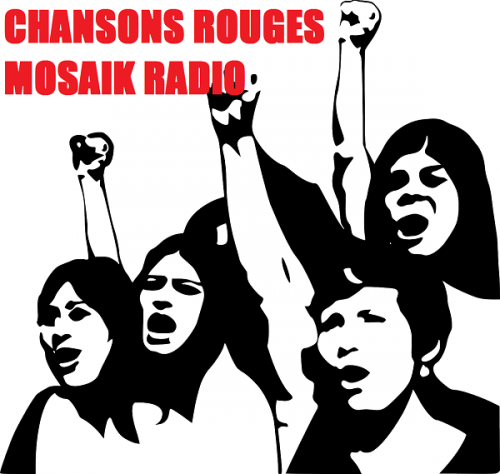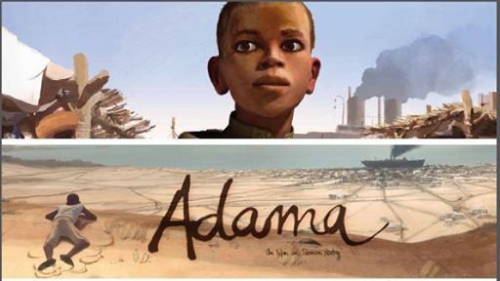14/04/2016
CHANSONS ROUGES MOSAIK RADIO
Nouvelle radio qui remplace la totalité des radios du groupe Mosaik Radios (Chansons Rouges, Mosaik Radio, Classik Radio) pour permettre une meilleure unicité et écoute.
Elle est diffusée sans publicité et permet des programmations plus importantes et plus diverses sans contraintes d'horaires et d'audimat.
Elle donne la priorité à la musique et à l'information en diffusant tous les jours douze magazines d'actualités politiques, sociales, culturelles, éducatives, sportives, musicales et 16 flashs d'informations générales
MAGAZINE HISTOIRE : LA COMMUNE DE PARIS
 La Commune de Paris période insurrectionnelle de l'histoire de Paris dura un peu plus de deux mois, du à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871.
La Commune de Paris période insurrectionnelle de l'histoire de Paris dura un peu plus de deux mois, du à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871.
Le magazine Histoire de la Radio Chanson Rouge Mosaik Radio pendant tout le mois d'avril diffusé le jeudi à 15h et le dimanche à 20h sera consacré à cet évènement avec Henri Guillemin qui a consacré une conférence sur la Commune de Paris. Au mois de mai l'intégralité de cette conférence vous sera proposé dans le cadre du magazine Panorama diffusé le dimanche à 15h et le jeudi à 20h.
LA GRILLE DE DIFFUSION
- Programme musical de chansons rouges, rebelles et révolutionnaires de France et du Monde entier en continu
L'INFORMATION
-Magazines d'informations du matin à 7h, 8h, 9h, 13h (flash, météo, sport, éphéméride, programmes TV, horoscope, magazines, chroniques)
-Magazines d'informations du soir à 17h et 19h
-Flash d'informations toutes les heures de 6h à 22h (sauf 21h)
-Le TOP 8h du matin magazine, 8h-8h30 (flash, édito, chroniques, magazine, reportages, rubriques diverses)
-Le TOP midi magazine , 12h-12h30 (flash, édito, chroniques, magazine, reportages, rubriques diverses)
-Le TOP 18h magazine , 18h-18h30 (flash, édito, chronique, magazine, reportage, rubriques diverses)
PLUS BELLES LES LUTTES, le lundi à 20h, émission proposée par les militants CGT des Bouches du Rhone
MAGAZINES THEMATIQUES 10H, 15H, 20H, 22H
Lundi : 10H : Entretiens avec des chanteurs et nouveautés musicales, 15H : Découverte recettes cuisine, 20H : Plus belles les luttes, 22H : Découverte Jazz
Mardi : 10H : Reportages, 15H : Découverte musique classique, 20H : Fréquence Terre
Mercredi : 10H - Cinéma, 15H : Hits rire des années 50 et 60, 20H : Reportages et débats, 22H : Découverte musique country
Jeudi : 10H : Découverte musique Jazz, 15H : Histoire, 20H : Panorama (conférences)
Vendredi : 10H : Découverte musique country, 15H : Cinéma, 20H : magazine cuisine, 22H : Hits et rire des années 1950-1960
Samedi : 10H - Fréquence Terre magazine de l'écologie, 15H - Entretiens avec des chanteurs, nouveautés musicales, 20H : Magazine cinéma
Dimanche : 1OH : Découverte musique classique, 15H : Panorama (conférences), 20H : Magazine Histoire, 22H : Découverte musique classique
LES SPÉCIALES :
TOUS EN BOITE DE 00H00 A 6H00 DU MATIN LE SAMEDI ET LE DIMANCHE - NUIT DISCO
17:43 Publié dans Actualité, Châteaux, Cinéma, Colonies, Culture, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Guerre d'Espagne, La Commune, Libération, Moyen âge, Musique, Occupation, Politique, Première guerre mondiale, Résistance, Révolution, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chansons rouges mosaik radio, histoire, la commune de paris |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2015
Cinéma : "Adama", un chef-d'oeuvre d'animation en l'honneur des Tirailleurs
À travers l'odyssée du jeune Adama dans l'enfer des tranchées, ce film nous conte l'histoire de ces Africains perdus dans la mémoire de la Grande Guerre.
Rendre compte du sort des tirailleurs sénégalais durant le carnage de la Première Guerre mondiale dans un film d'animation pour grands et surtout pour petits n'est pas une chose aisée. Pour son premier long métrage, entièrement conçu sur l'île de La Réunion par une cinquantaine de personnes pour un budget de quatre millions d'euros, le jeune réalisateur Simon Rouby a su frapper un grand coup. D'ailleurs, son film labellisé par la Mission du Centenaire a déjà participé à une trentaine de festivals aux quatre coins du monde, du Festival international du film d'animation d'Annecy au Children Film Festival Chicago en passant par le Film Africa London.
Ce conte moderne, à mille lieues des blockbusters aseptisés de Disney, reçoit en guest-star le rappeur Oxmo Puccino, qui non seulement prête sa voix à l'un des personnages du film mais a aussi composé le titre phare de la bande originale.
Une intrigue simple et efficace
L'aventure est menée tambour battant par un enfant en 1916. Du haut de ses douze ans, Adama décide seul de braver l'interdit des anciens en quittant son village d'Afrique de l'Ouest à la recherche de son frère aîné Samba.
Ce dernier s'est enfui pour se faire enrôler au sein de l'armée française dans une ville portuaire. Naïf mais obstiné, Adama part au péril de sa vie sur ses traces en France pour tenter de le ramener, car « le village est un endroit encore préservé, surtout aux yeux d'Adama, qui au début du film y vit comme dans un jardin d'Eden et n'a pas conscience de l'avancée inexorable du monde extérieur.
Pourtant, ce monde colonial et guerrier est en marche et le village ne pourra pas rester intact », explique le réalisateur. Sous les yeux enfantins du héros se dévoile la brutalité de l'enrôlement des tirailleurs sénégalais comme la tragédie subie par tous les soldats, blancs ou noirs, dans les tranchées de Verdun. « Si le film peut avoir comme impact de changer notre regard sur notre histoire, d'aider à comprendre que nos destins au Sud comme au Nord sont inexorablement liés, il aura fait œuvre utile », précise-t-il.
Le film s'inspire de la vie d'Abdoulaye N'Diaye
 Dernier survivant de la Force Noire envoyée par la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye N'Diaye allait enfin recevoir la Légion d'honneur en 1998 lors de la célébration des 80 ans de la victoire de 1918.
Dernier survivant de la Force Noire envoyée par la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye N'Diaye allait enfin recevoir la Légion d'honneur en 1998 lors de la célébration des 80 ans de la victoire de 1918.
Hélas, le 11 novembre, veille de la cérémonie d'honneur, Abdoulaye N'Diaye s'est éteint à 104 ans dans son village de Thiowor au nord de Dakar. Par chance, son petit-fils avait pu recueillir juste à temps les confidences de son aïeul, celles d'un homme contraint de quitter son village pour combattre dans un monde étranger. Le petit-fils les rapporta quelque temps plus tard à Julien Lilti, alors étudiant, qui deviendra coauteur du film Hippocrate, long-métrage nominé aux derniers Césars, et qui se rendra compte du potentiel du récit.
10:31 Publié dans Actualité, Colonies, Culture, Guerre, International, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adama, tirailleurs, simon rouby |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2015
SALARIES EN COLERE : JAURES, LE DISCOURS DU 19 JUIN 1906

Dans le conflit social qui agite Air France, des journalistes de l’Obs et de Radio France ont accusé des militants politiques et syndicaux de « mettre Jaurès à toutes les sauces » pour comprendre les violences ad hominem que Manuel Valls a qualifiées sans émouvoir lesdits journalistes d’« œuvres de voyous ».
Lors de la séance du 19 juin 1906 à la Chambre des députés, Jaurès résumait ainsi sa démonstration en répliquant à Georges Clemenceau, ministre de l’Intérieur : « Tandis que l’acte de violence de l’ouvrier apparaît toujours et est toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s’évanouit dans une sorte d’obscurité (…). »
En 1906, l’état de siège décrété par Clemenceau en réponse à la grève des mineurs
« Le patronat, venait-il de dire, n’a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans l’intimité d’un conseil d’administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclats de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l’universelle vindicte patronale. (..). »
En 1906, le climat social était particulièrement tendu au lendemain de la catastrophe minière de Courrières, la plus meurtrière d’Europe, ayant entraîné plus de 1 100 morts le 10 mars. Face à la grève générale des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, reconduisant leur mouvement par référendum en dépit de la division syndicale, Clemenceau avait promis de respecter le droit de grève s’ils s’abstenaient de violences. Mais des incidents entre mineurs survenus le 21 avril lui permirent de décréter l’état de siège, d’arrêter et de traduire en justice les leaders CGT qui dénonçaient les manquements de la compagnie aux règles de sécurité.
Plus largement, la CGT avait lancé une vaste campagne nationale pour réduire la journée de travail à huit heures. Le mouvement devant culminer le 1er mai 1906, la grande presse agita aussitôt le spectre du Grand Soir. Plus de 200 000 grévistes furent recensés à Paris et plus encore en province en dépit des interdictions et de l’arrestation des dirigeants anarcho-syndicalistes. Des heurts très violents opposèrent à Paris chasseurs à cheval et manifestants (650 arrestations). Mais les grèves et les heurts continuèrent en province alors que se préparaient les élections législatives qui virent une percée socialiste.
« Le maintien de l’ordre, c’est seulement (…) la répression de tous les excès de la force ouvrière »
Jaurès n’a jamais approuvé les méthodes d’action directe des minorités agissantes et a toujours cherché à renforcer et à unifier le mouvement ouvrier tout en respectant son autonomie. Le 19 juin à la Chambre, il réplique encore à Clemenceau, posant au gardien suprême de l’ordre social : « Ce que les classes dirigeantes entendent par le maintien de l’ordre, c’est seulement (…) la répression de tous les excès de la force ouvrière ; c’est aussi, sous prétexte d’en réprimer les écarts, de réprimer la force ouvrière elle-même et de laisser le champ libre à la seule violence patronale. »
Jusqu’à sa mort, n’en déplaise à certains, Jaurès a affirmé la réalité de la lutte des classes et de l’exploitation capitaliste. Face aux réformistes qui rêvaient de paix sociale, il répondait que la grève était certes une « méthode barbare » mais qu’elle « s’imposera tant que le capital et le travail seront séparés, tant que les grands moyens de production ne seront pas la propriété commune des travailleurs eux-mêmes et de la nation ». Dès 1901, il avait formulé la stratégie de l’« évolution révolutionnaire » visant à introduire dans la société capitaliste des « formes nouvelles de propriété nationales et sociales, communistes et prolétariennes, qui fassent peu à peu éclater les cadres du capitalisme ». En 1908, il fera adopter par le Parti socialiste un programme visant à « résorber et supprimer tout le capitalisme ».
« Ne tournons pas contre eux, mais contre les maîtres, notre indignation »
La démocratie politique ne lui suffit donc pas, même si la souveraineté du peuple exige le suffrage à la proportionnelle à tous les niveaux. La « souveraineté du travail », le pouvoir des travailleurs, doit être reconnue par la participation de leurs représentants dans les conseils d’administration des entreprises, privées comme publiques, avec des pouvoirs identiques à ceux des administrateurs et des actionnaires. Tel serait le gage du nouvel ordre social.
En 1912, Jaurès espérait encore contenir les grévistes par la force de l’organisation ouvrière unifiée. Mais, conseillait-il, « lorsque, malgré tout, la violence éclate, ne tournons pas contre eux, mais contre les maîtres, notre indignation ». On comprend que Manuel Valls ait reconnu dès 2006 « applaudir plus facilement le Tigre que le fondateur de l’Humanité ».
Publié par l'Humanité du 13 octobre 2015
11:18 Publié dans Actualité, Culture, L'Humanité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean jaurès, discours du 19 juin 1906, syndicalistes, air france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |