15/12/2024
Au Moyen Âge, porter une couleur, c’était endosser un rôle
Les couleurs des vêtements étaient bien plus que des choix esthétiques : elles reflétaient des hiérarchies sociales et des symboles religieux, définissant son statut dans la société.
Un point essentiel d'abord : les images des manuscrits ne sont pas des reflets fidèles de la réalité vestimentaire. Manuscrits et fresques utilisaient des codes symboliques : les couleurs et tenues servaient à exprimer des idées, non à documenter la mode de l’époque.
La durabilité des couleurs des vêtements médiévaux dépendait fortement de la qualité des matériaux. Les teintes vives se délavent avec le temps, particulièrement sur des tissus moins chers, tandis que les teintures coûteuses comme la pourpre tenaient mieux.
Ancrée dans une tradition lointaine, les vêtements servaient à afficher visuellement le statut. Les fortunés pouvaient se permettre des couleurs vives et des tissus luxueux, tandis que les classes inférieures portaient des matériaux moins coûteux dont la couleur s'étiolait.
La laine, accessible mais souvent terne, contrastait avec la soie ou le velours, réservés aux élites et permettant des teintures éclatantes et durables. le lin et le chanvre, sobres et naturels, incarnaient modestie et piété, tandis que la soie affichait richesse et pouvoir.
Le clergé, lui, adoptait des couleurs spécifiques pour ses habits liturgiques. Le rouge symbolisait le sang du Christ, le blanc la pureté, et le vert la vie éternelle, chaque teinte correspondant à une fête religieuse ou un moment précis du calendrier liturgique.
Certaines couleurs étaient réservées à des usages spécifiques : le pourpre, par exemple, était une teinte royale, symbole de pouvoir et d’autorité. Seuls les rois et les empereurs pouvaient porter cette couleur en raison de sa rareté et de son coût élevé.
Le bleu, aujourd’hui couleur royale par excellence, s’impose tardivement en Occident. D’abord lié à la Vierge Marie au XIIe siècle, il gagne son prestige avec les armoiries de Philippe VI. Avant lui, rouge et pourpre dominaient les symboles du pouvoir.
Les lois somptuaires, qui réglementaient l’usage des vêtements et des couleurs, limitaient l’accès à certaines teintes et tissus en fonction de la classe sociale.
La couleur noire, souvent perçue comme austère, était également une teinte de distinction. Les membres de l'élite portaient parfois des habits noirs pour afficher leur sérieux et leur respectabilité, loin des excès des couleurs vives.
La Réforme a aussi entraîné une réévaluation de l'extravagance dans l'habillement. Les protestants ont cherché à éviter les couleurs trop brillantes, qui étaient perçues comme des signes d’idolâtrie, au profit de vêtements plus modestes et plus fonctionnels.
16:30 Publié dans Culture, Moyen âge | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moyen age, vetement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
22/02/2024
22 février 1944 : le poète Robert Desnos est arrêté, avant d'être déporté vers « Nuit et brouillard »
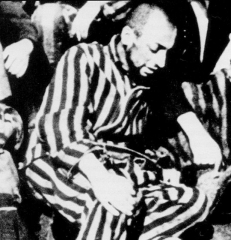 Il y a 80 ans, le résistant a été emmené pour un interrogatoire rue des Saussaies, à Paris, avant d’intégrer la prison de Fresnes. Ensuite le camp de Compiègne avant Auschwitz, puis Buchenwald, et encore les marches de la mort… pour finir à Terezin.
Il y a 80 ans, le résistant a été emmené pour un interrogatoire rue des Saussaies, à Paris, avant d’intégrer la prison de Fresnes. Ensuite le camp de Compiègne avant Auschwitz, puis Buchenwald, et encore les marches de la mort… pour finir à Terezin.
Par Olivier Barbarant, poète pour l'Humanité
Le téléphone est alors chose rare. Il vient d’être installé au 19, rue Mazarine. Il sonne fort tôt au matin de ce 22 février 1944, et une voix féminine put prévenir que la Gestapo sortait de la rédaction d’Aujourd’hui où elle pensait trouver Robert Desnos. Le poète contribue alors au journal depuis sa fondation, en septembre 1940, par Henri Jeanson, lequel a trouvé durant un bref automne le moyen d’y faire régner un esprit de liberté.
Jeanson vite écarté, Desnos a fait le choix d’y rester, glissant dans des chroniques apparemment anodines sur le cinéma, la musique ou la chanson un air plus pur que celui de la propagande, et souvent parfumé d’allusions. Il publie, anime des émissions de radio, travaille pour le cinéma, trouvant ainsi les moyens de subvenir aux besoins de sa compagne, Youki, mais aussi d’Alain Brieux, que le couple cache comme réfractaire à la loi du service du travail obligatoire (STO).
Desnos, le résistant
 Ce 22 février, Desnos lui ordonne de s’enfuir en lui confiant un paquet à jeter à l’égout. Brieux racontera plus tard qu’il croise dans l’escalier les trois agents en civil. Après la fouille mettant à sac une bibliothèque que Desnos a pris soin d’expurger en janvier, il est interrogé rue des Saussaies, puis expédié à la prison de Fresnes.
Ce 22 février, Desnos lui ordonne de s’enfuir en lui confiant un paquet à jeter à l’égout. Brieux racontera plus tard qu’il croise dans l’escalier les trois agents en civil. Après la fouille mettant à sac une bibliothèque que Desnos a pris soin d’expurger en janvier, il est interrogé rue des Saussaies, puis expédié à la prison de Fresnes.
Les motifs de l’arrestation ne manquent pas. Matricule P2 du réseau de résistance Agir, ajoutant des publications interdites sous pseudonyme aux contributions autorisées, hébergeant des clandestins, Desnos a parfois mêlé à l’action une certaine imprudence verbale. Une vieille polémique avec Céline dans Aujourd’hui en mars 1941, une plus violente querelle avec le secrétaire du collaborateur Alain Laubreaux avec lequel il en est venu aux mains au Harry’s Bar en 1942 ne sont que la part la plus parisienne d’autres audaces.
Il semble par exemple que les fusils cachés dans la cour, rue Mazarine, n’aient pas été trouvés par la Gestapo. Mais la suractivité artistique, militante et combattante de ces mois brouille les cartes. On peine à savoir ce que savaient les Allemands.
Il fallait l’aveuglement vitupérant des émules surréalistes de la Main à plume pour prétendre condamner en août 1943 « M. Desnos, collaborateur d’Aujourd’hui », quand le journal lui permettait d’accéder à des informations dont il glissait les transcriptions à son réseau…
Malgré ses incartades furieuses, la discrétion de Desnos lui fait taire aussi sa participation à la destruction d’un train de munitions en gare de Maintenon le 18 février 1944, où son camarade André Verdet affirme qu’il se trouvait. C’est le résistant Desnos qui est arrêté, peu après son chef Michel Hollard, torturé début février sans avoir lâché le moindre nom.
Commence alors un terrible chemin de croix. Transféré le 20 mars à Compiègne où il composera l’admirable poème Sol de Compiègne, comme un oratorio en amont des autres camps (« Craie et silex et herbe et craie et silex/Et silex et poussière et craie et silex »…), Desnos aurait pu être maintenu à Royallieu. Cette faveur arrachée par Youki auprès du responsable du camp est annulée par Laubreaux, qui a appris la nouvelle le 1er avril chez Maxim’s : « Pas déporté ! Vous devriez le fusiller. C’est un homme dangereux, un terroriste, un communiste. » L’assassin finira, lui, des jours tranquilles en 1968 dans l’Espagne de Franco…
Auschwitz et les marches de la mort
Arrivé le 30 avril à Auschwitz, réexpédié à Buchenwald le 12 mai, où l’on ajoute au tatouage d’identification le triangle rouge des politiques, transféré le 25 à Flossenbürg, Desnos trouve enfin le 2 juin sa destination dans la bureaucratie nazie tournant à plein régime : Flöha, où les détenus valides sont employés dans une usine d’armement. Par maladresse d’intellectuel ou sabotage (ils sont nombreux), Desnos est éloigné des machines et cantonné au balayage.
Tous les survivants racontent comment le poète, à chacune de ces destinations, est pour ses compagnons de malheur un soleil. Chansons, improvisations poétiques, organisation des séances d’épouillage sont opposées à l’enfer, tant qu’il en eut la force, la voix « chaude et joyeuse et résolue » du Veilleur du Pont-au-Change. Mais c’est roué de coups, les lunettes brisées après un conflit avec le kapo cuisinier que Desnos, épuisé, sera jeté sur les routes de l’évacuation des camps devant l’avancée des troupes alliées, du 14 avril au 7 mai 1945.
À Terezín enfin rejoint, où il est identifié par deux étudiants en médecine tchèques qui l’accompagneront jusqu’à sa fin, Desnos figure sur une photographie datée du 8 mai 1945. Celui qui peut donc apprendre la victoire, crâne rasé, maigre à faire peur, offre pout tout sourire à l’objectif qu’il peine à discerner une douloureuse grimace. Le typhus aura raison de ce qui lui reste de forces le 8 juin, à 5 h 30 du matin. Le Bain avec Andromède, publié clandestinement en 1944, avait su prédire le dernier mot : « Plus loin le monstre fuit./ Le ciel est dépassé ».
20:17 Publié dans Actualité, Biographie, Culture, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : desnos, poete |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
25/05/2023
LES BONS MOTS DE L'HISTOIRE : NAPOLEON DEVANT LES PYRAMIDES
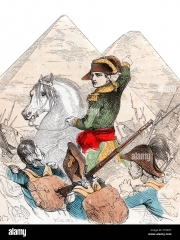 « SOLDATS, SONGEZ QUE, DU HAUT DE CES PYRAMIDES, QUARANTE SIÈCLES D'HISTOIRE VOUS CONTEMPLENT » BONAPARTE, 1798
« SOLDATS, SONGEZ QUE, DU HAUT DE CES PYRAMIDES, QUARANTE SIÈCLES D'HISTOIRE VOUS CONTEMPLENT » BONAPARTE, 1798
Cette citation trouve son origine lors de la Campagne d’Egypte de Napoléon Bonaparte qui commence en 1798 et s’achève en 1801.
Désireux d'éloigner un temps l'ambitieux général Bonaparte encore tout auréolé de ses victoires d'Arcole et de Rivoli, le Directoire lui assigne une nouvelle mission, la diffusion des Lumières en Orient. Cela doit permettre à l'Égypte, alors sous domination ottomane, de renouer avec sa gloire passée. Pour le jeune Corse, cette campagne a aussi pour dessein d'atténuer l'influence de l'Angleterre sur cette partie du monde et de couper la route des Indes à ses marchandises. Pour le gouvernement français, c'est le moyen le plus sûr d'empêcher un « sabre » glorieux de s'allier avec une partie des ministres les plus influents, en particulier celui des Relations extérieures, Charles Maurice de Talleyrand, avec qui il pourrait nourrir le projet de fomenter un coup d'État. En mai 1798, Bonaparte quitte Toulon à bord de l'Orient avec armes, bagages, et surtout 50 000 hommes - militaires, techniciens et savants embarqués sur plusieurs navires - pour l'une des plus fabuleuses expéditions
Une des plus célèbres batailles de cette campagne est la bataille des Pyramides qui a lieu le 21 juillet 1798. Cette bataille oppose l’armée française d’Orient à celle des Mamelouks de Mourad Bey, l’Egypte étant une province de l’Empire ottoman. Nous sommes à l’époque du Directoire, Napoléon n’est pas encore empereur. La bataille a lieu sur le site de Gizeh qui se situe en face du Caire, et c’est là que se trouvent les grandes pyramides de Kheops, Khepren et Mykerynos.
La citation sera ensuite diffusée sous des formes diverses : « Soldats, songez que du haut de ces monuments, quarante siècles vous contemplent » ou « Soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent ». Vous trouverez ici une histoire de ces variantes
Dans les Mémoires que Napoléon Bonaparte a dictés lors de sa détention à Sainte-Hélène, la phrase donnée est simplement : « Au moment de la bataille, Napoléon avait dit à ses troupes, en leur montrant les pyramides : « Soldats, quarante siècles vous contemplent »
Source : Mémoires de Napoléon, La campagne d’Egypte
Napoléon l'érudit voulait rappeler l'histoire noble de l'antiquité égyptienne, le "temps des pharaons", et se poser comme homme de science et de progrès face au désordre politique de l'Egypte en 1798.
D’autres livres sur Bonaparte et la Campagne d’Egypte :
L'Egypte: de l'expédition de Bonaparte à nos jours
Bonaparte et l'Egypte : feu et lumières [exposition], Institut du monde arabe, Paris, 14 octobre-19 mars 2009
L’égypte une aventure savante
 ECOUTEZ NOTRE PODCAST EXCLUSIF EN CLIQUANT SUR CETTE LIGNE CONSACRE A CET ARTICLE
ECOUTEZ NOTRE PODCAST EXCLUSIF EN CLIQUANT SUR CETTE LIGNE CONSACRE A CET ARTICLE
10:56 Publié dans Culture, Guerre, Histoire insolite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : napoleon, pyramides |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |










