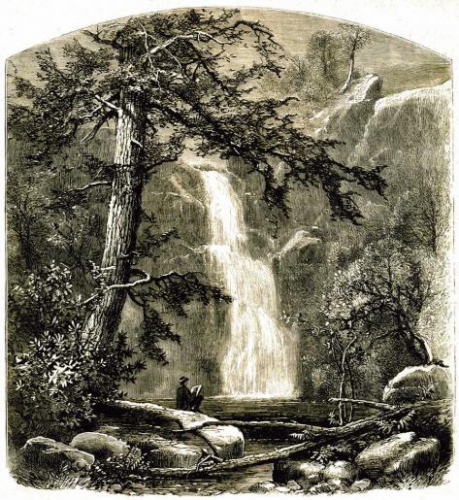14/04/2017
1917, une histoire soviétique
Jean-Paul Piérot, l'Humanité
En 1919, les troupes cosaques des Blancs lors de la guerre civile, en Sibérie. Bettman Archives/Getty Images
.Le centenaire de la révolution d’Octobre est l’occasion d’une riche production éditoriale. Parmi les nombreux ouvrages, ceux des deux historiens Marc Ferro et Jean-Jacques Marie.
Les Russes. L’esprit d’un peuple, éditions Tallandier, 222 pages, 19,90 euros. La Guerre des Russes blancs. 1917-1920 de Marc Ferro. de Jean-Jacques Marie. éditions Tallandier, 528 pages, 24,90 euros
L’histoire est une matière à risques. Marc Ferro ressuscite des souvenirs de jeunesse, lorsqu’il préparait, en URSS, sa thèse de doctorat au début des années 1960. Le livre, écrit à la première personne, fourmille d’anecdotes qui traduisent l’esprit d’une époque, une ambiance politique, la vie quotidienne. Le temps est alors à l’espoir : la dénonciation en 1956 par Nikita Khrouchtchev du culte de la personnalité de Staline, les premiers pas de la détente, la consommation participent de la confiance qu’incarne Youri Gagarine, héros de la conquête spatiale. Les zones d’ombre maintenues sur certaines pages du passé ne sont pas une spécialité soviétique – l’histoire du colonialisme français ne manque pas d’exemples, de Sétif à Madagascar – mais à Moscou, on continue de gommer des photos les personnages « négatifs ». Khrouchtchev lui-même n’y échappera pas.
En 1991, l’URSS s’effondre dans une quasi-indifférence de la population
Marc Ferro aborde le débat sur les deux révolutions de 1917, celle de février, qui entraîne la chute du tsar, et celle d’octobre, qui consacre l’accession du parti bolchevik au pouvoir. « La haine de l’autocratie, explique Marc Ferro, la misère du plus grand nombre constituaient un mélange explosif. » Privés de terres, sortis depuis un demi-siècle du servage, les paysans commencèrent à se saisir des propriétés. Dans l’armée, les galonnés qui envoyaient les soldats à la mort voulaient perpétuer l’ancien ordre. Lénine fut l’un des seuls dirigeants à « encourager la violence venue d’en bas » pour que « la dissolution de l’ancienne société s’accomplisse », ajoute l’historien. « À force de s’interroger sur la filiation entre Lénine et Staline, on a fini par ne plus prendre en considération l’appartenance de tous ces théoriciens à un courant plus large, qui entendait substituer l’État savant à l’État-nation ou à l’État de droit », estime Marc Ferro.
Quand bien des années plus tard, en 1985, Mikhaïl Gorbatchev lance le chantier de la perestroïka, a-t-il en vue de faire une « révolution sous la table » car l’opinion en savait encore moins qu’elle en savait auparavant sur les plans du régime soviétique ? La suite est connue : en 1991, l’URSS s’effondre dans une quasi-indifférence de la population. Le nouvel homme fort du Kremlin, Boris Eltsine, se soumet entièrement aux néolibéraux. Libération des prix, spoliation de l’épargne, hyperinflation ont paupérisé l’ensemble de la population. Une totale humiliation. Il n’y a pas d’autres explications à l’adhésion quelques années plus tard au discours nationaliste et autoritaire de Vladimir Poutine.
Mais revenons à l’automne 1917, quand le tout jeune gouvernement bolchevique est confronté à la guerre intérieure déclenchée par les généraux monarchistes déterminés à restaurer l’ordre ancien. Les conjurés – les Dénikine, Koltchak, Wrangel parmi les plus célèbres – sont appuyés par les forces occidentales d’intervention de l’Entente. Les alliés sont convaincus qu’un danger les menace, qui ne viendrait pas de l’extérieur, mais de l’intérieur de leurs propres pays, sous la forme d’une révolution sociale. S’ensuivront trois années effroyables pour les peuples de l’ex-empire des Romanov. La Sainte Alliance antibolchevik échouera à écraser la révolution. Le livre de Jean-Jacques Marie déroule un récit passionnant sur cette période trop méconnue de l’histoire de l’Union soviétique.
Cette tentative de restauration, qui sera plus tard le thème de l’épopée romanesque le Don paisible, de l’écrivain soviétique Mikhaïl Cholokhov, part du sud de la Russie. Les Cosaques forment le fer de lance de cette « armée des volontaires » mise sur pied par un triumvirat comprenant les généraux Kornilov, qui a déjà ourdi une tentative de putsch contre le gouvernement provisoire, Alexeïev et Dénikine.
La férocité de la guerre civile, explique Jean-Jacques Marie, a de multiples causes. La Première Guerre mondiale, en envoyant des millions d’hommes au carnage, a enlevé tout prix à la vie humaine. « Elle a accumulé dans le cœur des victimes une haine profonde pour ceux qui en étaient à leurs yeux les coupables. » Les ouvriers paysans et soldats exècrent les « bourgeois » ; les soldats paysans détestent les officiers qu’ils assimilent aux propriétaires. Le mépris des représentants de l’ancien régime vaincu vis-à-vis du peuple est immense. Pourquoi les Blancs ont-ils perdu ? L’auteur pointe l’absence de réponses aux aspirations sociales. Les chefs Blancs, souligne Jean-Jacques Marie, ne voient les bolcheviks que comme des meneurs, d’une « populace » méprisée et jamais n’évoquent les mesures prises par leurs adversaires : la socialisation de la terre, le droit de vote pour les femmes, la constitution d’une banque centrale, les nationalisations, l’interdiction du travail de nuit dans l’industrie pour les femmes et les jeunes de moins de 16 ans, l’annulation de la dette
18:47 Publié dans Livre, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, révolution, histoire, 1917 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
19/02/2017
LA NAISSANCE DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE
Révolution française de 1848
Le Peuple aux Tuileries, 24 février 1848
Nom donné au mouvement révolutionnaire de février 1848, qui substitua la IIe République à la monarchie de Juillet et prit fin le 26 juin 1848 avec l'écrasement des forces révolutionnnaires. Née dans un contexte de crise économique (1845-1847), cette révolution, s'insère dans un mouvement européen : les révolutions européennes de 1848.
1. La révolution de février
1.1. Fin de la monarchie de Juillet
Campagne des banquets
La fin de la monarchie de Juillet est marquée par un vaste mouvement favorable à une réforme électorale qui élargirait le pays légal et empêcherait la corruption des députés. À un moment où on s'enthousiasme pour l'Histoire de la Révolution (→ Michelet, Louis Blanc) ou l'Histoire des Girondins (Lamartine), les réformistes, muselés sur le plan légal, s'expriment dans de très nombreuses sociétés secrètes (→ Société des saisons, Travailleurs égalitaires) et détournent l'interdiction du droit de réunion en organisant, dans plusieurs villes, des banquets (campagne des banquets) qui réunissent des milliers de personnes.
Renvoi de Guizot et abdication de Louis-Philippe
Un de ces banquets, prévu à Paris le 22 février 1848, est interdit, mais les républicains invitent le peuple à manifester. Le 22, la troupe rétablit l'ordre, mais, le 23, le ralliement de la Garde nationale à la manifestation en faveur de la réforme provoque le renvoi de Guizot. Ce geste du roi ne suffit pas à faire cesser toute manifestation, et une fusillade boulevard des Capucines fait 52 morts et soulève Paris. Le 24 février, Louis-Philippe fait appel à Thiers, puis abdique.
1.2. Formation du gouvernement provisoire
La tentative de faire proclamer roi son petit-fils, le comte de Paris âgé de neuf ans, échoue. Un gouvernement provisoire est formé avec les républicains modérés du journal le National : Lamartine et Ledru-Rollin détiennent respectivement les deux ministères clés des Affaires étrangères et de l'Intérieur ; les avocats Marie et Crémieux se voient attribuer respectivement les Travaux publics et la Justice ; le physicien Arago est nommé à la Marine, le négociant Garnier-Pagès aux Finances. Dupont de l'Eure devient président honorifique du Conseil, tandis qu'Armand Marrast, le rédacteur en chef du National, privé de ministère, sera nommé à la mairie de Paris.
De tendance plus revendicative, les représentants du mouvement ouvrier proches du journal la Réforme Louis Blanc, l'ouvrier Albert et Flocon, le directeur du journal, sont imposés par la foule parisienne mais n'obtiennent aucun ministère.
2. L'œuvre du gouvernement provisoire
2.1. Réformes sociales et libertés politiques
Ce gouvernement proclame la république (25 février), le droit au travail, crée pour les chômeurs des ateliers nationaux, institue la Commission du gouvernement pour les travailleurs (ou Commission du Luxembourg) présidée par Louis Blanc.
Il ouvre la Garde nationale à tous, supprime la peine de mort en matière politique (26 février) et l'esclavage dans les colonies françaises (27 avril) grâce à la persuasion de Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État à la Marine.
Il rétablit la liberté de réunion et la liberté de presse. Mais, principale innovation de la IIe République, il instaure le suffrage universel (pour les hommes de plus de 21 ans).
2.2. Mécontentement et agitation
Le gouvernement provisoire convoque les électeurs pour élire, le 9 avril, une Assemblée constituante. Mais la révolution accroît les difficultés économiques : augmentation des charges de l'État, fuite des capitaux, qui provoque une crise bancaire, chute de la rente. Pour rétablir la situation, Garnier-Pagès, ministre des Finances, adopte des mesures impopulaires, en particulier l'accroissement de l'impôt de 45 centimes par franc. Le mécontentement et l'agitation politique persistent. Par la manifestation ouvrière du 17 mars, les groupes d'extrême gauche obtiennent le report des élections au 23 avril, mais une nouvelle manifestation, le 16 avril, ne fait pas fléchir le gouvernement et les modérés, dominés par la peur du socialisme.
2.3. Vers la Commission exécutive
Les élections des 23 et 24 avril amènent à la Chambre une majorité modérée. Le gouvernement provisoire est remplacé le 10 mai par une Commission exécutive (Arago, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine, Ledru-Rollin, seul radical à ne pas être exclu), et les troubles de province (Rouen, Limoges) sont réprimés.
3. L'écrasement de la République sociale
3.1. La journée du 15 mai
À la suite de la manifestation parisienne en faveur de l'indépendance polonaise (15 mai), menée par la gauche, hostile à l'exclusion des socialistes du pouvoir, le mouvement révolutionnaire est brisé : la Commission du Luxembourg est supprimée, tous les clubs d'extrême gauche fermés ; l'ouvrier Albert, Raspail, Blanqui, Barbès sont arrêtés.
3.2. Les journées de juin
La dissolution des ateliers nationaux
Un décret du 21 juin prononce la dissolution de fait des ateliers nationaux, obligeant les ouvriers de moins de 25 ans à s'engager dans l'armée et les autres à gagner la province, faute de quoi ils ne seront plus soldés.
Après le refus de Marie de recevoir une délégation conduite par Pujol, l'agitation ouvrière commence alors et culmine le 23 dans un élan spontané, sans aucune véritable direction politique.
La répression de l'insurrection parisienne par Cavaignac
 Le 24 juin, la Commission exécutive confie les pleins pouvoirs au général Cavaignac, ministre de la Guerre, afin de mettre en échec les insurgés qui dressent des barricades dans toute la capitale. Dès le 24 au soir, la révolte ouvrière est contenue : l'Hôtel de Ville n'a pas été pris par les insurgés et les troupes enlèvent le Panthéon. Le 25 au matin, les barricades sont prises d'assaut au cours de combats sanglants où Mgr Affre, l'archevêque de Paris, est tué au cours d'une tentative de conciliation faubourg Saint-Antoine. Les derniers combats se déroulent le 26.
Le 24 juin, la Commission exécutive confie les pleins pouvoirs au général Cavaignac, ministre de la Guerre, afin de mettre en échec les insurgés qui dressent des barricades dans toute la capitale. Dès le 24 au soir, la révolte ouvrière est contenue : l'Hôtel de Ville n'a pas été pris par les insurgés et les troupes enlèvent le Panthéon. Le 25 au matin, les barricades sont prises d'assaut au cours de combats sanglants où Mgr Affre, l'archevêque de Paris, est tué au cours d'une tentative de conciliation faubourg Saint-Antoine. Les derniers combats se déroulent le 26.
Ces journées ont coûté la vie de 1 600 hommes du côté de l'armée et de 4 000 du côté des insurgés. La répression sera très dure : environ 15 000 hommes seront arrêtés et 4 300 déportés en Algérie.
La victoire des conservateurs
Influencé par le « comité de la rue de Poitiers » – des conservateurs de tous bords (→ Thiers, Rémusat, Berryer, Falloux et Montalembert) réunis dans l'amphithéâtre de l'Académie de médecine, rue de Poitiers – qui donnera naissance au parti de l'Ordre, Cavaignac prend des mesures de réaction : lois sur la presse rétablissant momentanément un cautionnement, loi sur les clubs, astreints à une déclaration deux jours avant leur ouverture.
Après la promulgation de la Constitution, en novembre, les conservateurs consolident leur position : d'abord avec l'élection au suffrage universel de Louis Napoléon Bonaparte, comme président de la République (10 décembre), puis par leur succès aux législatives (13 mai 1849). Le parti de l'Ordre obtient deux tiers des sièges, alors que les républicains modérés n'ont que 80 députés, deux fois moins que les républicains avancés, la Montagne, qui disposent de 180 sièges.
En savoir plus sur http://www.larousse.fr
20:31 Publié dans Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution 1848, 2 ème république |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
02/01/2017
Récit. Comment on devient Élisée Reclus
Alain Nicolas, L'Humanité
Fils de pasteur et promis à la carrière de son père, il devint géographe, militant anarchiste et communard. Thomas Giraud trace le parcours sensible de ses années de formation.
Parti pour être pasteur, il revient géographe. Élisée (1830-1905)n’aura pas le destin que rêvait pour son fils Jacques Reclus, l’intransigeant pasteur calviniste de Sainte-Foy-la-Grande. Des quatorze enfants de Jacques et Zéline, plusieurs seront savants, marins, médecins, mais Élisée est le seul dont le nom ait quelque écho de nos jours. De notre mémoire reviennent quelques images fugaces, une tête barbue et chevelue d’un autre siècle, qui pourrait bien appartenir à la troupe des savants farfelus qui jouent les seconds rôles dans Tintin. On pense aussi géographie, anarchie, commune, prison. C’est peu.
Doux et inflexible
L’entreprise de Thomas Giraud est donc bienvenue, qui nous donne pour compagnon, le temps d’une lecture, cet homme qu’on imagine doux et inflexible. Confiance en l’avenir au plus noir de la défaite, refus du compromis, souci d’accorder au plus juste vie personnelle et histoire, Élisée Reclus semble répondre à un appel de notre présent. Élisée n’est pourtant pas une biographie au sens classique du terme. Les informations sur un personnage historique tel que Reclus ne sont pas difficiles à réunir avec les moyens contemporains. Un essai sur l’anarchisme aujourd’hui serait certainement utile. Moins attendue, plus profonde, est l’évocation sensible que nous propose Thomas Giraud.
Il y a un malentendu sur Élisée Reclus : « Selon les points de vue, on dira que c’est un grand savant, un humaniste à la Diderot, touche-à-tout curieux, ou bien on le décrit comme un original, confus et dilettante, dispersé, toujours impécunieux. » L’ampleur même, la variété des domaines auxquels il s’attache, le dessert. Thomas Giraud ne vise pas à le réhabiliter – il n’en a nul besoin –, mais à saisir à leur source sa curiosité et ses enthousiasmes.
émergence d’une conscience
Il le montre ainsi parcourant, très jeune, la France à pied, ralliant Nieuwied, en Allemagne, puis Orthez, attentif aux pierres, aux montagnes, aux ruisseaux. Et aux hommes, à leurs travaux et à leurs conditions de vie. Il l’imagine, enfant, ramassant des cailloux, en emplissant ses poches, jouant avec l’encre en rêvant de ses futures cartes. Ou peut-être de son projet de globe terrestre de 127 mètres de diamètre, posé sur la colline de Chaillot pour l’instruction des masses. Élisée écoute les sermons de son père, inquiétant ses ouailles, tentant de secouer leur résignation, leur passivité, de les éclairer d’une pensée sinueuse, tortueuse jusqu’à la contradiction.
Élisée et son frère Élie, s’ennuyant au séminaire de Nieuwied, finissant par le quitter, parcourant les campagnes, travaillant dans les fermes. Telles sont les images que fait naître Thomas Giraud, images de formation avant les grands accomplissements d’Élisée. La géographie n’est pas encore là, ni l’anarchie, mais ce qui va leur donner naissance s’élabore dans l’incorporation des paysages, la rencontre de grévistes, la résistance au destin voulu par le père.
Pas de biographie détaillée donc, pas même « les enfances d’Élisée Reclus », mais une tentative d’habiter poétiquement une conscience en train de s’accoucher elle-même, tel est le projet d’Élisée. Chaque fleuve franchi, chaque montagne gravie, chaque sillon retourné, chaque ouvrier croisé rapproche l’enfant du savant et du révolutionnaire qu’il deviendra. Thomas Giraud nous donne la certitude que le rendez-vous ne sera pas manqué.
18:44 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Élisée reclus |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |