24/08/2013
Victor Hugues, corsaire de la Révolution
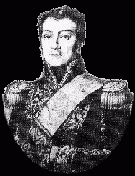 1761-1826 . Personnage énigmatique, le commissaire civil délégué par la Convention aux Isles-du-Vent a épousé tous les méandres de son époque.
1761-1826 . Personnage énigmatique, le commissaire civil délégué par la Convention aux Isles-du-Vent a épousé tous les méandres de son époque.
À la Guadeloupe, il usa de l'émancipation des esclaves noirs comme d'une arme dans la guerre contre l'Angleterre, ralliant à son armée les nouveaux libres acquis à la cause républicaine, faisant tomber les têtes des colons blancs royalistes.
Le même, huit ans plus tard, fit appliquer avec zèle, à la Guyane, le décret de Bonaparte rétablissant l'esclavage.
«C ette nuit j'ai vu se dresser à nouveau la Machine. C'était, à la proue, comme une porte ouverte sur le ciel. » Surle pont du navire qui transporte le commissaire civil délégué par la Convention aux Isles-du-Vent, une guillotine se dresse, redoutable instrument enfanté par la terreur et la vertu. La lugubre vision ouvre le Siècle des Lumières, le roman que le Cubain Alejo Carpentier consacra à l'équivoque personnage de Victor Hugues.
Investi de pouvoirs illimités par le Comité de salut public, le révolutionnaire débarque au Gosier, en Guadeloupe, à la fin du printemps 1794. Il apporte le décret du 16 pluviôse qui « abolit l'esclavage des Nègres dans les colonies ». Adopté par la Convention nationale après que Léger-Félicité Sonthonax et Étienne Polverel eurent proclamé l'émancipation des esclaves de Saint-Domingue, le texte dispose que « tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution ». Victor Hugues est chargé de faire appliquer la nouvelle législation dans les colonies françaises de la Caraïbe.
Ce fils d'un boulanger marseillais, qui s'est embarqué dès l'âge de treize ans comme mousse à destination des Amériques, est un personnage énigmatique. Tour à tour flibustier, commerçant, imprimeur, il séjourne pendant près de dix ans à Saint-Domingue, où il fréquente une loge maçonnique et s'imprègne des idéaux des Lumières. À la veille de l'insurrection des esclaves dirigée par Toussaint Louverture, Victor Hugues, pourtant philanthrope et humaniste, se méfie des revendications égalitaires des libres de couleur. Chez lui, comme chez la plupart des révolutionnaires, un incommensurable abîme sépare encore le réel de l'idéal. Fuyant les troubles qui agitent la Grande Île, il revient en France au début de 1790. À Paris, il se mêle aux sans-culottes, affûte ses talents de polémiste, rejoint le club des Jacobins. Un rôle d'accusateur public au tribunal révolutionnaire de Rochefort, puis de Brest, forgera sa réputation de procureur impitoyable.
Lorsqu'il revient dans la Caraïbe, en juin 1794, son mandat tient en quelques mots : « Établir solidement les principes de la Révolution dans les Isles-du-Vent, y défendre la République contre toute agression étrangère (...), punir exemplairement les contre-révolutionnaires. » Dans ces îles d'Amérique se joue alors l'un des actes de la guerre opposant la jeune République à la coalition des monarchies d'Europe. Le 23 mars, malgré la résistance des troupes de Rochambeau, la Martinique est tombée aux mains des Anglais avec l'appui des colons blancs royalistes, opposés à cette abolition au nom de laquelle ont éclaté maintes insurrections. La Guadeloupe, elle aussi, est occupée.
 La reconquête de cette dernière est impensable sans l'appui des esclaves noirs, majoritaires dans l'île. Habile tacticien, Victor Hugues usera de leur émancipation comme d'une arme. « Libérer les Noirs, c'était créer une armée pour combattre les maîtres d'esclaves, alliés des Anglais », résume l'historien martiniquais Armand Nicolas. Dès le 7 juin, le commissaire proclame l'abolition et recrute une armée de Noirs et de Mulâtres qui repousse la flotte anglaise et reprend possession de la Grande-Terre. Le 6 octobre 1794, les Anglais capitulent à Basse-Terre. Victor Hugues se retourne dès lors contre leurs complices. Le Tribunal révolutionnaire qu'il installe fait fonctionner la Machine à plein régime. Les têtes des planteurs royalistes tombent. Ceux qui échappent à la guillotine prennent la fuite. En 1790, l'île compte 9 371 Blancs. Cinq ans plus tard, ils ne sont plus que 1 092, dont 255 hommes.
La reconquête de cette dernière est impensable sans l'appui des esclaves noirs, majoritaires dans l'île. Habile tacticien, Victor Hugues usera de leur émancipation comme d'une arme. « Libérer les Noirs, c'était créer une armée pour combattre les maîtres d'esclaves, alliés des Anglais », résume l'historien martiniquais Armand Nicolas. Dès le 7 juin, le commissaire proclame l'abolition et recrute une armée de Noirs et de Mulâtres qui repousse la flotte anglaise et reprend possession de la Grande-Terre. Le 6 octobre 1794, les Anglais capitulent à Basse-Terre. Victor Hugues se retourne dès lors contre leurs complices. Le Tribunal révolutionnaire qu'il installe fait fonctionner la Machine à plein régime. Les têtes des planteurs royalistes tombent. Ceux qui échappent à la guillotine prennent la fuite. En 1790, l'île compte 9 371 Blancs. Cinq ans plus tard, ils ne sont plus que 1 092, dont 255 hommes.
Mais le camp « contre-révolutionnaire » s'étend à mesure que s'affirme l'intransigeance de l'Investi de pouvoirs. De nouveaux affranchis hostiles au système de travail « forcé » institué par les autorités révolutionnaires sur les habitations abandonnées par les maîtres seront, eux aussi, conduits à l'échafaud. Il reste qu'au coeur même de la Terreur, le nouveau régime, avec toutes ses contradictions, fait souffler sur la colonie un vent de liberté.
La Guadeloupe reconquise par la République, Victor Hugues en fait une base arrière de ses offensives contre les Anglais. Il noue des alliances avec les Indiens Caraïbes de Saint-Vincent, regagne Sainte-Lucie, lance des corsaires à l'assaut des navires de la rivale impériale, s'accommode de la revente des esclaves pris aux Anglais. Si les multiples tentatives pour reprendre possession de la Martinique n'ont pas réussi, cette « guerre de course » terrorise l'ennemi et assure à la Guadeloupe des rentrées financières appréciées de Paris.
Louant le « caractère empli d'énergie et d'audace » de cet homme « d'apparence médiocre, de manières vulgaires, de mauvaise éducation », l'aventurier Alexandre Moreau de Jonnès rapporte que Victor Hugues « lutta contre ses ennemis avec un bonheur dont aucun autre, avant et après lui, n'a pu donner l'exemple ».
À la Guadeloupe, il se fait gestionnaire sourcilleux, inflexible gardien de la séparation des pouvoirs, pourfendeur des croyances religieuses. Ce fin politique, mû par l'obsession de l'ordre, régentera l'île durant quatre ans.
Dans ce nouveau monde lointain, où l'écho des bouleversements qui se nouent à Paris parvient à contretemps, le coup d'État du 9 thermidor ne signe pas la chute du « Robespierre des îles ». Ses détracteurs invoqueront sa duplicité, plutôt que la distance, pour expliquer son exceptionnelle longévité. L'homme, il est vrai, sait louvoyer, contourner les tempêtes, épouser jusqu'à se dédire les méandres de son époque. En décembre 1798, le Directoire le rappelle à Paris. Un an plus tard, le Consulat le dépêche en Guyane, où il institue un régime de travail forcé, prélude au rétablissement de l'esclavage. Victor Hugues, commissaire, puis proconsul de la colonie, fera exécuter le décret du 30 floréal an X rendant les anciens esclaves à leurs chaînes avec autant de zèle qu'il fit appliquer en Guadeloupe le décret d'abolition de la Convention. « Si rétablir l'esclavage est une nécessité politique, je dois m'incliner devant elle », lui fait dire Alejo Carpentier.
Victor Hugues fait ensuite appliquer à la lettre le Code civil, qui interdit strictement les mariages entre Noirs et Blancs, n'admet l'adoption qu'entre personnes de même couleur, frappe de nullité les donations d'un Blanc à un Noir. On dit le proconsul autoritaire, orageux, tyrannique. L'impôt qu'il instaure, surtout, cristallise le mécontentement à son endroit.
Déporté au bagne de Cayenne après le coup d'État de fructidor, le journaliste et chansonnier monarchiste Louis-Ange Pitou brosse de lui un portrait aussi féroce qu'admiratif : « Son caractère est un mélange incompréhensible de bien et de mal ; il est brave et menteur à l'excès, cruel et sensible, politique, inconséquent et indiscret, téméraire et pusillanime, despote et rampant, ambitieux et fourbe, parfois loyal et simple ; son coeur ne mûrit aucune affection ; il porte tout à l'excès : quoique les impressions passent dans son âme avec la rapidité de la foudre, elles y laissent toutes une empreinte marquée et terrible ; il reconnaît le mérite lors même qu'il l'opprime : il dévore un esprit faible ; il respecte, il craint un adversaire dangereux dont il triomphe. (...) Le crime et la vertu ne lui répugnent pas plus à employer l'un que l'autre, quoiqu'il en sache bien faire la différence. (...) Il est administrateur sévère, juge équitable et éclairé quand il n'écoute que sa conscience et ses lumières. C'est un excellent homme dans les crises difficiles où il n'y a rien à ménager. »
Après la conquête de la Guyane par les Portugais, en 1809, Victor Hugues est accusé de trahison, puis acquitté. Il est rétabli dans ses fonctions en 1817. Il s'éteint en 1826, après avoir traversé tous les régimes. Arrivé au Nouveau Monde avec la liberté, il aura emprunté sans états d'âme les chemins tortueux qui menèrent à la restauration de l'ancienne servitude.
Rosa Moussaoui
Voir [tous les Portraits de la Révolution->http://www.humanite.fr/+-Revolution-francaise-220-ans-apres-+]
11:40 Publié dans Biographie, L'Humanité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugues, révolution française, guadeloupe, esclavage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
18/08/2013
VICTOR JARA : ON LUI COUPA LES DOIGTS PUIS LES MAINS POUR QU‘IL NE CHANTE PLUS !
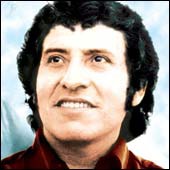 Tout d'un coup Victor essaya péniblement de se lever et comme un somnambule, se dirigea vers les gradins, ses pas mal assurés, et l'on entendit sa voix qui nous interpellait :
Tout d'un coup Victor essaya péniblement de se lever et comme un somnambule, se dirigea vers les gradins, ses pas mal assurés, et l'on entendit sa voix qui nous interpellait :
" On va faire plaisir au commandant. " Levant ses mains dégoulinantes de sang, d'une voix angoissée, il commença à chanter l'hymne de l'Unité populaire, que tout le monde reprit en choeur.
C'en était trop pour les militaires ; on tira une rafale et Victor se plia en avant.
Chili, 40 ans. Anniversaire du coup d’Etat de Pinochet (11 septembre 1973, 11 septembre 2013)
"Savez-vous pourquoi il n'y a jamais eu de coup d'Etat aux Etats-Unis ? Parce qu'il n'y a pas d'ambassade des Etats-Unis aux Etats-Unis..." Michelle Bachelet, ancienne Présidente du Chili (fille d'un général assassiné avec la complicité des Etats Unis).
VICTOR JARA
Les mots ne sont pas innocents. On ne défie pas impunément le pouvoir, surtout s'il est entre les mains de dictateurs sanguinaires. Victor Jara en fit l'amère constat, payant de sa vie son engagement militant auprès de Salvador Allende au Chili.
Chantre de la révolution communiste, Victor Jara chantait le partage des terres, critiquait le conformisme bourgeois, dénonçait la répression militaire, condamnait la guerre du Vietnam…
Après le coup d'état du Général Pinochet, Victor Jara fut arrêté et emprisonné dans le stade de Santiago, lieu de triste mémoire. Il fut torturé et exécuté.
Pinochet a échappé à ses juges. Le monde de justice rêvé par Jara n'est pas pour demain.
" On amena Victor et on lui ordonna de mettre les mains sur la table. Dans celles de l'officier, une hache apparut.
D'un coup sec il coupa les doigts de la main gauche, puis d'un autre coup, ceux de la main droite.
On entendit les doigts tomber sur le sol en bois. Le corps de Victor s'écroula lourdement. On entendit le hurlement collectif de 6 000 détenus.
L'officier se précipita sur le corps du chanteur-guitariste en criant : " Chante maintenant pour ta putain de mère ", et il continua à le rouer de coups.
Tout d'un coup Victor essaya péniblement de se lever et comme un somnambule, se dirigea vers les gradins, ses pas mal assurés, et l'on entendit sa voix qui nous interpellait :
" On va faire plaisir au commandant. " Levant ses mains dégoulinantes de sang, d'une voix angoissée, il commença à chanter l'hymne de l'Unité populaire, que tout le monde reprit en choeur.
C'en était trop pour les militaires ; on tira une rafale et Victor se plia en avant.
D'autres rafales se firent entendre, destinées celles-là à ceux qui avaient chanté avec Victor. Il y eut un véritable écroulement de corps, tombant criblés de balles. Les cris des blessés étaient épouvantables. Mais Victor ne les entendait pas. Il était mort. "
Miguel Cabezas (extrait d'un article paru dans l'Humanité du 13 janvier 2000).
Le stade porte aujourd'hui son nom.
12:07 Publié dans Actualité, Biographie, Chili : 1973-2013, L'Humanité, Musique, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor jara, chili, allende, pinochet, usa |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
02/08/2013
AGROECOLOGIE : QUI SEME BIEN, NOURRIT BIEN !
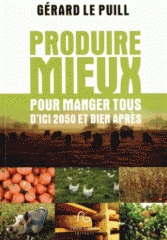 Il y a ce qui plombe l’agriculture moderne – la surexploitation, la dérégulation et plus généralement la persistance des idées commises en son temps par David Ricardo. Et il y a ce qui peut la sauver. La première catégorie est depuis toujours la bête noire de Gérard Le Puill. Journaliste, essayiste et confrère au long cours
(il officie pour le magazine la Terre et ici même, à l’Huma, depuis près de trente ans), il n’a de cesse de lui faire la peau au fil de ses chroniques et de ses livres.
Il y a ce qui plombe l’agriculture moderne – la surexploitation, la dérégulation et plus généralement la persistance des idées commises en son temps par David Ricardo. Et il y a ce qui peut la sauver. La première catégorie est depuis toujours la bête noire de Gérard Le Puill. Journaliste, essayiste et confrère au long cours
(il officie pour le magazine la Terre et ici même, à l’Huma, depuis près de trente ans), il n’a de cesse de lui faire la peau au fil de ses chroniques et de ses livres.
Sorti en juin, Produire mieux pour manger tous, son dernier ouvrage, n’y coupe pas, lequel taille un costard à l’agent de change anglais qui, à l’aube du XIXe siècle, ouvrit la voie à l’agriculture industrielle mondialisée. David Ricardo, donc, célèbre pour avoir fondé la théorie des avantages comparatifs, défendant l’idée que chaque nation doit se spécialiser dans l’exploitation de ses ressources naturelles les plus abondantes. Libre au commerce de décider, par la suite, de la répartition des productions à l’échelle planétaire. C’est ainsi, note Gérard Le Puill, que la Grande-Bretagne a sacrifié son agriculture, préférant s’appuyer sur les denrées que lui fournissaient l’Inde ou la Nouvelle-Zélande. Le temps des colonies a chu, les théories ricardiennes non, qui nourrissent toujours les politiques européennes ou les orientations de l’OMC.
D’elles, et de la quête du profit tous azimuts, découle le reste. L’accaparement des terres, leur surexploitation, l’usage intensif d’engrais et de pesticides pour les grandes monocultures, la spéculation sur le blé et le riz. Ou les lasagnes au cheval. En bout de course, une agriculture qui use la Terre, sans bien nourrir les hommes.
Fatalité ? Non, répond Gérard Le Puill. Après Planète alimentaire et Demain nous aurons faim, le journaliste boucle ici sa réflexion, entamée en 2008, par un propos sinon optimiste, en tout cas combatif. Reprenant à son compte l’expérience de ceux qui défrichent d’autres voies, il en fournit des exemples, étayés de son analyse. Coureur de campagnes, éplucheur de rapports et autres études exhumés de l’histoire moderne ou des tiroirs bruxellois, Gérard Le Puill le démontre et interpelle au passage Xavier Beulin, président de la puissante FNSEA : oui, une agriculture soutenable et capable de nourrir les 9 milliards d’humains que nous serons d’ici à 2050 est possible. À condition d’en assurer « une gestion économique à haute valeur écologique », écrit-il, tirant le lien avec la « règle verte et la transition écologique défendues par Jean-Luc Mélenchon ». Cela peut passer par l’économie des fourrages ou la redécouverte de la luzerne ; par l’amélioration foncière des prairies et le bon usage de la production céréalière ; par la relance des cultures potagères ou encore l’optimisation de l’emploi des fumiers. À l’heure où il s’agit également de réduire nos émissions de CO2, cela exige, surtout, la relocalisation de cultures diversifiées et l’exploitation judicieuse de toutes les terres, sur tous les territoires. « Revendiquer la souveraineté alimentaire implique de produire sur le sol de la nation tout ce qu’il est possible de produire de manière pérenne », résume ce fils de paysans bretons, qui plaide pour que l’agriculture redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une activité de proximité.
Produire mieux pour manger tous d’ici à 2050 et bien après, de Gérard Le Puill. Pascal Galodé éditeurs, 320 pages, 21,90 euros.
- Durant la Fête de l’Humanité, Gérard Le Puill présentera son ouvrage au village de l’économie sociale et solidaire, au village du livre et au stand de la Terre.
09:28 Publié dans Actualité, Culture, L'Humanité, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agriculture, agriculture verte, le puill, l'humanité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |






