06/07/2014
JOSE MARTI : LE HEROS CUBAIN !
José Marti (1853-1895) est sans conteste la figure la plus importante du XIXe siècle cubain. Cité par les révolutionnaires de Fidel Castro comme « l'auteur intellectuel » et l'inspirateur de la Révolution cubaine, il est à l'origine de la création au XIXe siècle de la conscience continentale d'une Amérique métisse, celle qu'il nomma « Notre Amérique », en opposition à l'Amérique anglo-saxonne du Nord.
Il prit la défense des Noirs et des Indiens, fut l'organisateur et le premier dirigeant de la Guerre révolutionnaire d'indépendance de Cuba en 1895 - Cuba est alors une colonie espagnole -, le fondateur du Parti révolutionnaire cubain (1892), celui qui formula pour la première fois une doctrine américaine anti-impérialiste.
Il est aujourd'hui l'inspirateur non seulement des dirigeants et intellectuels cubains, mais aussi de la plupart des pays de l'Amérique latine. Il fut aussi poète, critique littéraire et journaliste, reconnu dans toute l'Amérique. La célèbre chanson Guantbnamera s'inspire de son recueil de poèmes Versos sencillos (1891).
Déporté en Espagne très jeune, il voyagea dans toute l'Amérique latine (Mexique, Guatemala, Venezuela) et aux Etats Unis et fonda de multiples revues éphémères.
Initiateur du soulèvement anticolonialiste de 1895, il débarqua à Cuba (comme le fit Fidel Castro quelques années plus tard) accompagné d'un détachement armé, mais fut tué lors de sa première bataille contre les Espagnos.
Il est depuis considéré comme un martyr et un mythe de l'indépendance de Cuba et de l'Amérique latine.*
José Martí est certainement l'homme le plus glorifié par le peuple cubain, qui le considère comme le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour indépendance.
José Martí est né à la Havane le 20 janvier 1853. Rapidement il s'engagea dans la lutte anti-coloniale, à quinze ans, déjà, il fondait un journal nationaliste, à 16 ans il était arrêté pour trahison et condamné à six ans de travaux forcés.
Libéré six mois plus tard et assigné à résidence, il fut déporté en Espagne durant quatre années. Son exil se poursuivit en France, en Angleterre, au Mexique.
Une amnistie des prisonniers politiques lui permet de revenir à Cuba, où il fut de nouveau arrêté et de nouveau renvoyé en Espagne.
Il s'installa à New York, où vivaient de nombreux exilés cubains, et durant les quinze années qui suivirent il se consacra sans relâche à l'activité politique au sein du parti révolutionnaire cubain.
Son objectif était d'obtenir l'indépendance de Cuba en s'appuyant sur le peuple et les masses opprimées, d'obtenir l'égalité raciale, égalité économique et l'égalité des sexes.
Il débarqua sur l'île en 1895, et fut tué lors de sa première bataille contre les Espagnols, le 19 mai 1895.
* - José Marti, la liberté de Cuba et l'Amarique latine, Jean Lamore, édition Ellipses.
18:16 Publié dans Biographie, International, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cuba, josé marti, amérique latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2014
UN DESTIN HORS DU COMMUN : HENRI KRASUCKI !
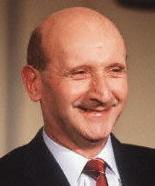 Henri Krasucki, ancien secrétaire général de la CGT pendant dix ans de 1982 à 1992, décédé le 24 Janvier 2003 à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie à son domicile dans la banlieue parisienne.
Henri Krasucki, ancien secrétaire général de la CGT pendant dix ans de 1982 à 1992, décédé le 24 Janvier 2003 à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie à son domicile dans la banlieue parisienne.
Henri Krasucki a marqué l'histoire de la CGT et fut également un grand témoin de l'histoire du XXe siècle.
Résistant, déporté en 1943 à Auschwitz puis à Buchenwald, dirigeant communiste, il avait été secrétaire général de la CGT de 1982 à 1992. M. Krasucki avait succédé à Georges Séguy.
Né en 1924 en Pologne dans une famille juive et arrivé en France à l'âge
de quatre ans, le jeune Henri Krasucki s'est engagé très tôt dans le militantisme. En 1938, il participe aux activités des Jeunesses communistes avant de s'engager dans la Résistance pendant la Seconde guerre mondiale.
Déporté en 1943 à Auschwitz puis à Buchenwald, Henri Krasucki revient en France et travaille un moment comme ouvrier-ajusteur chez Renault. Très vite, il commence son ascension au sein de l'appareil de la CGT.
Membre de la commission administrative de la confédération à partir de 1955, il rentre officiellement au Bureau confédéral en 1961.
Un moment pressenti pour prendre la tête du syndicat en 1967, c'est finalement Georges Séguy qui l'emporte. Henri Krasucki ne prendra la tête de la confédération que quinze ans plus tard, en 1982.
En 1992, il avait cédé la place à Louis Viannet à la tête de la CGT.
Le président Jacques Chirac avait salué "une grande figure du syndicalisme, interlocuteur engagé et de conviction". M. Chirac a rendu hommage "au fils d'immigrés polonais dont la jeunesse a été très tôt marquée par le combat pour la liberté et pour la France et qui a connu le drame de la déportation alors qu'il n'avait pas vingt ans".
La CGT, dont il a été le secrétaire général pendant 10 ans, a salué un "dirigeant historique" qui "a consacré son intelligence et son énergie au combat pour la dignité et l'avenir de l'Homme". "La CGT, ses organisations, ses militantes, ses militants garderont le souvenir d'un homme cultivé, rigoureux, épris de liberté et de justice, toujours disponible pour les accompagner et les soutenir dans leurs luttes émancipatrices".
La secrétaire nationale du PCF de l'époque Marie-George Buffet avait salué "avec émotion et beaucoup de respect" la mémoire du "camarade Henri Krasucki". "Premier dirigeant de la CGT, résistant, déporté, son passé est connu : c'est le passé d'un homme d'honneur, d'un homme engagé, d'un militant syndicaliste et communiste", a-t-elle ajouté.
19:36 Publié dans Biographie, Déportation, Libération, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : krasuski, cgt, résistant, déporté |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |
30/05/2014
CATHERINE II, LA GRANDE, L'AGE D'OR DE LA RUSSIE !
Cette année la Russie célèbre le 285e anniversaire de l’impératrice, dont le règne est considéré comme l’" âge d’or » de l’Empire russe par les historiens. C’est sous Catherine II la Grande qu’étaient menées les réformes à la manière de celles des Lumières en France, et que les fondements de la société civile moderne russe ont été posés. En politique étrangère, l'impératrice a réussi à transformer la Russie en une puissance européenne de premier plan.
Les contemporains voyaient en Catherine La Grande une impératrice énergique et sage. Les historiens sont du même avis. En nourrissant un vif intérêt pour les sciences et la politique, l'impératrice a pu mener avec succès non seulement des réformes internes du pays, s’inscrivant dans l’esprit des réformes des Lumières, mais aussi défendre les intérêts de la Russie sur l'arène internationale. Elle a brillamment mené deux guerres contre l’Empire Ottoman, ce qui lui a permis de renforcer les positions de la Russie en mer Noire. Ainsi le littoral Nord de la mer Noire, la Crimée et la région de Kouban ont été attachés à la Russie. Par ailleurs, la Géorgie orientale a été mise sous le protectorat russe. Ensemble avec l’Autriche et la Prusse, Catherine II a également participé à trois partages de la Pologne. À la suite de ces partages, l’Empire russe a pu non seulement récupérer ses régions occidentales, mais a également mis la main sur de nouveaux territoires, souligne le chercheur de l’Institut d'histoire générale de l’Académie des sciences de Russie, docteur en histoire, Vadim Roguinski.
" Ce furent des opérations brillamment réussies. Si l’on observe la carte de la Russie du milieu du 17e siècle, lorsque Catherine II est arrivée au pouvoir, et on la compare à 1796, l’année de sa mort, on peut voir que les frontières se sont élargies, ce qui est très important du point de vue des représentations de l’époque.»
Rôle crucial pour l’indépendance de l’Amérique
Catherine II a également joué un rôle important dans le processus de création des États-Unis. En automne 1775 le roi anglais George III a envoyé un message à l'impératrice russe lui demandant d'envoyer 20.000 soldats russes pour réprimer la rébellion en Amérique. Mais Catherine, en dépit de son opposition aux émeutes contre les monarques légitimes de l'Angleterre, a refusé d’aider l’Angleterre, rétorquant qu’elle ne vend pas ses sujets.
" Catherine a largement contribué à l’indépendance de l’Amérique », raconte le docteur en sciences historiques Igor Kouroukine. " Nous n’avons pas combattu aux côtés des Américains, mais la Russie a refusé d’aider les Anglais. Ces derniers ont notamment demandé des soldats à l'Empire russe pour les transférer vers leur colonie pour qu’ils puissent combattre contre les Américains. Mais l'impératrice a refusé".
Une impératrice " éclairée "
Catherine avait la réputation d’être une femme éclairée. Elle correspondait avec les grands philosophes et écrivains du Vieux Monde, composait elle-même des pièces de théâtre, écrivait des romans. C’est elle, qui a posé les fondements de la société russe moderne.
" C’est elle qui a fondé ce que nous appelons aujourd’hui société civile", explique l’historien russe Alexandre Kamenski. " Cela a également influencé la vision du monde par les Russes. L'apparition du sens de civisme, et la formation des sentiments patriotiques – tout cela lui est dû. Les Russes ont commencé à se sentir non seulement comme sujets, mais aussi comme citoyens".
Ce n’est pas un hasard que le règne de Catherine II est considéré comme l’" âge d’or " de l'Etat russe. C’est sous l’impératrice, une armée forte et une flotte puissante ont été créées. Sa période de règne était accompagnée par un essor de l’artisanat, de l’art, et la formation d’un système d’enseignement primaire. Toutes ces institutions se sont conservées en Russie aujourd’hui.
Par Ksenia Melnikova, La Voix de la Russie – RIA Novosti
19:13 Publié dans Actualité, Biographie, International, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine ii, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook |
Facebook |








